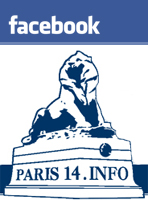mardi, 16 novembre 2021
Isabelle Demongeot


Isabelle Demongeot est une ancienne joueuse de tennis professionnelle. Elle a été n°1 française mais a subi un véritable traumatisme puisqu’elle a été violée pendant plusieurs années par son entraîneur Régis de Camaret. Lundi 22 novembre va être diffusée sur TF1 une fiction tirée de son histoire et de son livre « service volé « écrit il y a déjà plusieurs années… C’est l’occasion de s’entretenir avec elle.
Mais avant écoutons Patrice Hagelauer ancien coach de Noah lors de sa victoire à Roland Garros parler d'elle :
" J'ai admiré la joueuse et à aucun moment sur le circuit on la sentait dans une situation aussi dramatique que celle qu'elle a pu vivre. Elle formait une petite équipe à l'époque un peu à part avec Nathalie Tauziat et leur entraîneur Régis de Camaret. Ce dernier essayait de mettre des barrières avec la fédération prétextant que personne ne savait enseigner correctement. C'était probablement une manière pour lui de rester à l'écart sans que personne ne vienne voir un peu ce qui se tramait. On allait les voir de temps en temps car les résultats étaient excellents mais les contacts étaient assez distants. On n'a jamais pu vraiment percer ce qui se passait derrière et lorsqu'on a appris la vérité on était tous effondrés.
Le jeu d'Isabelle était pur, très complet; elle savait tout faire. C'était à la fois élégant et efficace, avec un sacré tempérament. Quand on la voyait jouer, on se disait " Le tennis c'est facile".
C'est une personne rare et riche , très intelligente qui a envie et besoin d'enseigner et de transmettre ses connaissances et son expérience. Discuter avec elle a quelque chose d'exceptionnel car elle ne parle pas souvent ni de ce qui lui est arrivée ni de ce qu'elle voudrait ou pourrait faire pour le tennis. La fédération aurait tout intérêt à la prendre en considération.."
Deuxième avis celui de Florence de La Courtie ex n° 1 française et entraîneur reconnu : "C'est un coach extraordinaire. Mes petits fils dès que ça ne va pas vont la voir alors qu'ils ne jouent pas si mal que ça. L'un est à O et l'autre à 2.6. Ils adorent être entraînés par elle. A chaque fois, elle est très dure sur le terrain mais elle leur donne la pêche et ils sont vraiment heureux de travailler avec elle. Et tous les entraineurs n'ont pas ces qualités là!...
J'espère que ça va aller pour elle car c'est une fille qui a énormément de qualités et qui a beaucoup souffert. C'est vraiment regrettable qu'à l'époque la Fédération n'ait pas trouvé une solution avant que les problèmes n'éclatent. Car il y a quand même eu 20 filles qui ont témoigné contre Régis de Camaret. Ce qui est dommage c'est qu' Isabelle soit davantage connue pour ce qu'elle a vécu que pour son palmarès tennistique..."
Interview
Un film sur le drame que tu as vécu va être diffusé sur TF1 lundi 22 novembre. Que ressens-tu ?
Tout s’est un peu précipité et le film est sorti un peu plus tôt que prévu. Mais je m’y suis préparée et c’est la fin d’un processus après l’écriture de mon livre. J’ai trouvé que c’était intéressant de prendre un petit peu de recul par rapport à toute cette histoire en déléguant à une actrice Julie de Bona qui joue merveilleusement ce rôle. Et j’ai envie de dire que c’est quelque chose qui ne m’appartient plus.
Concernant le déroulement du film, as-tu laissé complètement libre cours à l’équipe ou es-tu intervenue quelque peu ?
Cela fait 3 ans que l’on est sur le projet et c’est Jérôme Foulon le producteur qui est venu à moi et qui m’a dit qu’il avait envie de tourner quelque chose. Et je dois dire que l’on a fait un bon travail ensemble. Il a écouté, fait quelques interviews de différentes personnes, est retourné sur les lieux. Pour moi, forcément c’est une forme de reconnaissance avec une chaîne de télé qui propose de montrer ce qui m’est malheureusement arrivée. C’est un projet dans lequel je me suis beaucoup investie. Cela se passe dans mon village, la partie que j’adore qui est le côté de La Ponche avec de très belles images du côté sauvage. On a tourné évidemment quelques scènes dans mon petit club et je précise que c’est une fiction adaptée de mon livre intitulé « Service volé ». Je ne suis pas allée tous les jours sur le tournage et n’ai pas assisté à toutes les prises de vue car l’actrice redoutait de devoir affronter mon regard quand elle jouait les scènes. Ce n’était pas simple pour elle. J’ai respecté totalement sa demande mais je ne pouvais pas tenir et il fallait que je rencontre les acteurs et actrices , tout ce petit monde qui a d’ailleurs été extraordinaire avec moi. Cela m’a permis de vivre des choses inconnues jusqu’alors et qui font du bien comme mon père qui prend la parole , qui dit être fière de moi à la fois comme une femme qui porte un message et qui dénonce des agissements et également comme joueuse de tennis. J’ai ressenti de belles émotions et je me dis que c’est arrivé au bon moment et que c’était chouette.
Et maintenant que deviens-tu ?
Ma passion pour le tennis m’accompagne toujours. J’ai envie d’exprimer beaucoup de choses sur l’enseignement puisque cela fait des années que je suis dedans. Après mon expérience au centre d’entraînement avec Amélie Mauresmo et plusieurs autres joueurs et la création de mon association « Tennis en liberté » dans les quartiers sensibles, j’ai souhaité toucher à l’aspect loisir et j’avoue que je m’y adonne régulièrement à Ramatuelle un très bel endroit. J’ai beaucoup réfléchi à cet aspect d’accueillir un joueur de tennis qui a envie, peu importe son niveau, de ressentir des choses, d’évoluer, d’apprendre. C’est primordial qu’on le respecte de A à Z. Et qu’il puisse repartir avec quelques notions supplémentaires. J’y ai mis toute mon énergie comme si c’était une Amélie Mauresmo ou un joueur ayant envie de devenir pro. Ayant exercé au sein d’un centre d’entraînement aves des joueurs et joueuses de haut niveau et d’un autre côté ayant goûté au tennis loisir, j’avoue mieux m’y retrouver dans le tennis loisir….
Pourquoi ?
Car une forme de reconnaissance s’installe. Déjà il règne beaucoup moins de pression, et il existe un véritable échange. A l’époque des joueurs n’ayant pas les moyens de payer me demandaient de leur faire des prix… C'était très peu financé, or l’entrainement se déroulait jour et nuit. C’est un encadrement total et qui est parfois épuisant. Sans compter que du jour au lendemain le joueur ou la joueuse est capable de nous quitter en deux minutes ayant envie de changer d’encadrement et d’entraîneur. A l’époque, lorsque j’ai monté mon centre d’entraînement, j’avais dans l’idée de faire en sorte que les enseignements soient sur une forme de turn over et que ce ne soit pas toujours le même entraîneur qui entraîne la même joueuse ou le même joueur. Que l’on puisse arriver à échanger ensemble et que chacun apporte sa petite pierre à l’édifice, afin que le joueur se développe totalement. Mon combat est là aussi. Il ne se borne pas à parler uniquement des femmes victimes et isolées. L’entraîneur, l’enseignant doit essayer d’adopter un comportement plus juste et ne pas aller à l’encontre de ce que l’élève souhaite aussi. C’est un vrai échange, partenariat et aujourd’hui c’est essentiel dans l’apprentissage. C’est à plusieurs que l’on pourrait former de nouveaux champions et championnes. Je ne crois plus à l’isolement d’un enseignant ou d’un prof qui pense qu’il a la science infuse et qu’il va réussir..
J’avais un peu d’avance dans les années 99-2000 puisque c’est là qu’Amélie Mauresmo a éclaté au plus haut niveau mondial. Mais les enseignants ou les coaches de ma structure n’ont pas réussi à échanger et à le mettre en pratique. Ainsi un Christophe Fournerie qui était détaché pour s’occuper d’Amélie Mauresmo pendant quelques mois, lorsque je lui ai demandé de s’occuper de joueurs et joueuses de la structure, et que je lui ai annoncé que ce serait Sophie Collardey qui reprendrait, il n’a pas supporté. A présent, l’enseignant ne doit absolument pas devenir indispensable à son joueur à tel point que celui-ci soit totalement emprisonné et sous la coupe de cet entraîneur. Plein d’autres personnes pourraient lui donner de bons conseils.
C’est un vrai travail d’équipe que tu proposes ?
Oui, j’y crois vraiment et l’on peut d’ailleurs s’en rendre compte lorsque l’on observe les joueurs et joueuses de haut niveau. Il existe toute une équipe autour. Nadal, Federer se sont entourés d’anciens joueurs expérimentés et dotés d’une certaine approche. Une victime isolée, c’est très mauvais, un entraineur isolé aussi. Et c’est là où je trouve que notre fédération a le plus gros travail à effectuer. Il faut arrêter de mettre les clubs ou les coaches en concurrence et qu’un joueur de Saint-tropez puisse aussi aller s’entraîner dans d’autres clubs aux alentours. Et pourquoi pas bénéficier de coaches travaillant sur place. C’est dommage d’avoir un joueur tous les jours en face de soi et de ne pas ouvrir le discours vers d’autres enseignants. Ce n’est pas du tout dans l’air du temps, et il faut changer les mentalités. Je pousse vraiment dans ce sens là en essayant de créer une dynamique entre clubs, et que l’on soit capable de vivre différentes expériences..
Tu as eu l’occasion de travailler avec Mauresmo lorsqu’elle était junior. Que penses-tu lui avoir apporté et qu’avez-vous travaillé ensemble ?
Je dirigeais la structure et ne voulais pas partir sur les tournois. J’avoue qu’à cette époque là je n’avais totalement repris la confiance en moi que j’ai acquise à l’heure actuelle pour peut-être la mener au plus haut niveau. En tout cas, j’avais peur d’y aller et j’avais envie d’une pause voyage et de ne plus préparer mon sac. En revanche, j’ai essayé de faire en sorte de lui procurer des entraîneurs disponibles et motivés pour ce challenge. Quand on l’a récupérée, elle était championne du monde juniors et en quelque temps elle s’est retrouvée en finale de l’Open d’Australie. Elle savait que j’étais présente, j’encadrais, je surveillais et j’avais un œil sur l’entraîneur qui s’occupait d’elle. J’étais un peu comme une médiatrice par moment, et elle savait que si ça n’allait pas, elle pouvait me parler. Mais c'était compliqué car on avait une joueuse très talentueuse, qui en même temps était en train de vivre une vie amoureuse avec une de mes meilleures amies. J’aurais aimé comme elle a su le faire après la guider vers plus de travail et d’assiduité à l’entraînement. Mais finalement c’est peut-être en Australie qu’elle a joué son meilleur tennis car elle était libérée psychologiquement. Effectivement, elle avait déclaré son homosexualité et je crois que ce fut un moment très fort aussi.
C’’est un fait que j’ai joué surtout la carte avec Amélie de savoir comment elle allait pourvoir vivre avec cette particularité. Et ce n’était pas simple. On a d’ailleurs pu voir tout ce qui s’est passé en Australie. Elle avait un revers fantastique qui tuait littéralement ses adversaires sur place mais c’était dur de la motiver côté travail. On était encore sur son talent, ses acquis et le travail dépendait de sa bonne volonté. Je me suis battue un peu avec cette situation en lui disant que pour atteindre la plus haute marche, il s’agissait de s’investir davantage. Finalement, elle a décidé de quitter la structure et c’est ce qu’elle a fait après avec ses divers coaches. Que ce soit Alexia Dechaume ou Loïc Courteau. Ce fut une belle expérience, je ne regrette pas du tout mais il y avait de gros enjeux difficiles à gérer. C’ était une Amélie Mauresmo encore jeune et presque ado…
As-tu des idées vu le drame que tu as subi pour qu’il y ait moins d’agressions sexuelles ?
Mon idée repose surtout sur tout ce qui se rapporte à l’enseignement. Il faut que l’on arrive à faire pratiquer du beau tennis, de beaux gestes. Et l’on doit mettre les bouchées doubles lorsque l’on a affaire à de petites jeunes filles au sein de l’école de tennis et au mini-tennis. Pour moi c’est de là que ça part, c’est le starter. Nos meilleurs coaches doivent être dans cette palette là pour apporter le plus d’éléments possibles . Je dois dire que je me suis un peu embêtée par moment dans le tennis féminin avec un jeu trop stéréotypé et j’avoue être un peu nostalgique. Est-ce la faute des enseignants, des coaches, des joueuses ? On ne sait plus trop aujourd’hui qui est la meilleure au monde, ça change tout le temps et on n’a plus vraiment de repères. Mon idée c’est de délivrer un peu de fun et de plaisir sur un court et je ne suis pas sûre que toutes ces joueuses soient dans cette dynamique là et ça me dérange. Il me semble que l’on a un gros travail à réaliser à ce niveau là. Au départ, le joueur doit effectuer un certain travail, c’est une évidence. Il doit être un peu besogneux pour acquérir toute une gamme de coups. Ce qui m’a fait plaisir en tout cas c’est qu’on vu revenir des coups comme le shop et l’amortie. Puis on a vu se développer davantage de joueurs dotés d’un revers à une main. On avait entendu à un moment donné certains joueurs qui disaient » Le revers à une main c’est fini, ce n’est plus à la mode, ça ne sert plus à rien, il ne faut plus enseigner que le revers à deux mains." Mais pour moi, le revers à une main reste le coup le plus magique et le plus beau du monde car il se joue totalement relâché. Et permet un jeu vers l’avant, vers la volée, vers le développement d’un jeu plus fin.
J’ai l’impression que tous ceux qui ont appris un jeu besogneux de fond de court, à faire des ronds, des lifts à outrance, aujourd’hui ont un peu décroché. Ils gagnaient peut-être quand ils étaient jeunes, mais plus après. C’est un peu ce que j’ai subi avec ce monstre d’entraîneur. Il m’a empêchée de développer un tennis vers l’avant, or j’étais faite pour ça. Pour aller à la volée, pour avoir un chop de revers et pas un tennis de contre et de renvoi. Et c’est très important d’arriver à amener le joueur dans des zones où il se sent bien.
Que penses-tu des joueuses françaises d’aujourd’hui ?
C’est un peu compliqué en ce moment. Le Covid a aussi beaucoup terni le circuit. Des filles comme Mladenovic, Garcia sont en train de décliner un petit peu mais la concurrence est rude. Ont-elles fait les bons choix à un moment donné concernant leur entourage ? Caroline aurait pu ne pas avoir toujours comme accompagnateur son père et peut-être s’octroyer des coaches un peu plus renommés. Ou tenter une expérience avec des étrangers. Il n’existe pas que la technique française, il est bien d’aller piocher ailleurs. Actuellement, j’ai un jeune qui joue très bien, j’ai envie de lui dire » Va faire ton expérience en Espagne, va découvrir un peu tous les secteurs de jeux avec des terrains différents." C’est cela qu’il faut absolument apporter. Nos jeunes joueuses comme Burel et autres sont intéressantes mais elles n’arrivent pas encore véritablement à percer. Pourquoi ? Je ne suis pas assez le tennis pour pouvoir véritablement répondre à cela, mais les derniers résultats de la Coupe Billie Jean King sont assez décevants. Il y a encore du boulot, un travail mental est nécessaire c’est une évidence. On n’a peut-être pas non plus assez la niaque qui consiste à passer des heures à peaufiner où à construire de nouveaux gestes. On n’est pas prêt à cela.
As-tu un rôle au sein de la fédération ?
Au nom de l’affaire Sarah Abitbol qui m’avait beaucoup touchée en 2020, j’avais fait un article dans l’Equipe où je disais espérer qu’un jour on tendrait la main à toutes ces victimes. Fin 2020, la fédération est enfin venue vers moi. Je suis prestataire de service et je réfléchis sur la thématique de la protection des mineurs mais pas uniquement. J’avais besoin aussi que l’on me respecte, que l’on me reconnaisse dans mes qualités d’enseignante. Et d’ancienne joueuse évidemment. Je joue encore aujourd’hui, je donne des leçons sur le terrain, frappe la balle et on m’a demandé comment relancer le tennis loisir. J’ai fait toute une étude là-dessus. Ainsi que sur le mur que j’ai demandé à remettre absolument au cœur de nos pratiques. A l’âge de 6,7,8,9 ans un enfant qui joue contre un autre enfant qui ne renvoie pas la balle est habité par une certaine frustration. Or s’il tape contre un mur, la balle revient toujours. J’ai développé toute une réflexion à ce sujet sur les sens et l’ouïe, le son de la balle et sa trajectoire contre un mur. Ce travail parle énormément aux enfants et les résultats sont concluants. La fédération a tout ceci en main aujourd’hui et j’espère que l’on va pouvoir développer ensemble mes suggestions dans les prochains mois avec la nouvelle direction qui a envie d’évoluer. J’espère pouvoir continuer à leur côté pour faire en sorte d’approfondir et ça me plaît. J’aurais pu à l’époque en 90, arrêter ma carrière tennis et dire « Il faut que je sorte de tout ça, que j’oublie toute cette période et couper avec le tennis. Et bien non. J’ai fait le choix de toujours y rester et je prends énormément de plaisir. C’est incroyable combien ce tennis m’anime encore en tout cas dans ma tête. C’est une remise en question comme quand j’étais joueuse. Je suis capable chaque soir de faire un bilan des joueurs que j’ai pu avoir en loisir et de me dire comment puis-je faire pour que ce soit encore mieux et faire passer des étapes à mes élèves.
C’est beau cette passion du tennis ! Tu joues encore pour toi-même ?
Je n’avais plus envie de faire de compétition, je ne voulais plus être restreinte à mettre la balle dans le cours, plus envie de compter les points. C’est quelque chose qui me permet de me défouler. J’ai pu faire une compétition pour les plus de 40 ans et suis partie en nouvelle Zélande où malheureusement on a subi un tremblement de terre. Mais la compétition pour moi ce n’est plus d’actualité. Récemment j’ai fait de la compétition dans une toute autre activité qui s’appelle le pickabull qui fait fureur aux Etats-Unis avec une balle en plastique. Une activité qui demande beaucoup moins financièrement en tout cas pour les clubs comparé à la mise en place d’un paddle . C’est une activité qui m’a beaucoup plu. J’ai fait les championnats de France et j’ai perdu en finale du double mixte. C’était très chouette et très convivial. Je joue encore très bien et par moment je me challenge.
Je vais raconter une petite expérience que j’ai vécue il n’y a pas longtemps avec un client. C’est un joueur américain en vacances à Saint Tropez qui m’a demandé de taper la balle. Il était dans le challenge, et avait envie de se préparer en vue d’un événement de double. Il m’a proposé de faire un match où il avait les couloirs de double et pas moi. Je ne sais pas si tu imagines mon cerveau qui pendant 40 ans n’allait pas chercher les balles dans le couloir et qui du jour au lendemain devait changer son fusil d’épaule. Il m’a fallu quelques jours pour que je conditionne et c’était un nouveau challenge. Côté enseignement, j’arrive toujours à me projeter sur un challenge personnel et c’était une belle expérience. On a bien rigolé ensemble après et je lui ai que ce qu’il me demandait m’avait obligé à retourner mon cerveau…
C’est une constante adaptation !
Oui c’est ça. J’ai envie de former des enseignants et leur dire « regardez », « écouter », « véhiculez une image positive. Il faut penser à l’énergie que l’on va déployer lorsque l’on donne un cours, sa voix et l’attention que l’on porte à l’élève. Je trouve qu’avec les enfants, trop d’enseignants s’en foutent. C’est dommage mais je ne veux pas parler de cette réalité. Je souhaite que l’on retourne dans les clubs à la base et il faut que l’on revalorise les coaches et qu’on leur redonne envie d’avoir envie.
Justement quels sont les erreurs que tu as pu constater chez les enseignants ?
Trop souvent c’est de la garderie avec trop d’enfants sur un court ; ce n’est pas possible. Il y a aussi trop de demandes des parents qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant ne joue pas mieux. Il ne joue qu’une fois par semaine, donc… Nous lorsque nous étions enfants quand on jouait une première fois ,on rejouait à côté avec les copains ou contre un mur. Si l’enfant n’est pas demandé par l’enseignant à venir pour un cours, il ne revient pas de lui-même. Il y a toute une éducation à fournir avec un mode de vie qui a changé. Je vois trop souvent les enseignants sur les portables, peu motivés pour faire progresser l’enfant quelque soit son niveau. Il y a des enfants talentueux d’autres beaucoup moins ; il y en a qui sont en grande difficulté et ceux là il faut quand même s’en occuper. Donc l’enseignant qui est apathique et qui ne bouge plus sur un court de tennis, pour moi c’est très néfaste pour notre sport.
Et la relation avec les parents. Comment un enseignant doit-il se comporter avec les parents ?
C’est un vaste sujet. Certains enseignants de clubs passent aussi beaucoup de temps à discuter avec les parents en dehors du court. C’est épuisant par moment et on nous demande aussi des résultats très rapides sans vraiment fournir des efforts à côté. J’ai enseigné il y a quelques années au Racing Club Lagardère et je dirigeais l’école de compétition. On demande beaucoup d’efforts aux coaches et je trouve que les générations d’aujourd’hui ne sont pas prêtes à véritablement s’impliquer davantage. Je dirais que la séance service que j’ai demandée à beaucoup de jeunes consistant à retravailler tout seul ce coup dans leur club, je l’ai rarement vue reproduite. On ne peut pas faire de miracle. L’enseignement pour moi c’est de taper un maximum de balles pendant 1 heure. C’est notre objectif. L’objectif de l’école suédoise c’est je crois de taper au moins 200 balles dans l’heure, on en est loin en France. Rien qu’en regardant les sceaux de balles des enseignants où il y a à peine 20 balles dedans c’est significatif. Je ne voiis pas comment on peut s’en sortir pour obtenir plus de résultat. Même si on ne peut pas faire que des champions, si on renforce un peu notre base avec un certain nombre de joueurs qui jouent bien au tennis, qui ont une belle technique, c’est déjà satisfaisant . Un enseignant doit pouvoir amener son joueur au moins en seconde série. Avoir mis le cota d’un enseignant à 15/2 me paraît peu judicieux. Je n’ai rien contre ce niveau là mais je pense que quand on est enseignant, une bonne qualité de balle est nécessaire. Sinon, il ne peut pas donner du plaisir ni en prendre et inciter son joueur à en redemander.
On aurait d’ailleurs bien besoin de femmes et de mixité dans les clubs. Pour moi, une femme à 3/6 a toutes les possibilités de répondre à tous les niveaux de clientèle à entraîner. Je suis passée comme directrice de l’école de tennis de Villiers Le Bel, à l’époque une activité très prisée, où je n’étais pas salariée à l’année. J’étais en libéral et si le joueur ne revient pas le lendemain, tu ne manges pas.. C’est aussi simple que ça. Les cours que tu donnes, les joueurs que tu approches, il faut leur donner envie de revenir.
On voit l’expérience de la sportive de haut niveau qui a travaillé dur !
Voilà oui, et je suis obligée de continuer à travailler dur. Mais mon corps fatigue, et je dois dire qu’à certains moments, je suis contente de pouvoir faire évoluer mon sport par le biais demes réflexions. Avec un peu moins de terrain quand même car parfois je fatigue. On vieillit ! 55 ans. Mais je prends un sacré plaisir à taper dans la balle et par moment c’est un pur bonheur.
Tu as une fille ?
Oui, ma petite Cloé sans H. Elle a 7 ans, est mignonne comme tout et c’est le centre de ma vie aujourd’hui. Je suis malheureusement séparée de ma femme et je m’adapte ; elle aussi. Ma fille est en train de me découvrir et ça fait du bien. Par rapport à tout ce que j’ai pu traverser c’est le bonheur de ma vie et quand je suis avec elle, je suis avec elle.
Elle joue au tennis ?
Oui mais rarement sur un court car j’ai eu un gros problème de santé à l’oreille, et je n’ai pas pu taper dans une balle pendant deux ans. Je l’ai fait jouer dans l’appartement, sur une pelouse. Je mettais les filets un peu n’importe où et avec lors du confinement je suis partie à Porquerolles avec elle. Et on a fait des trucs incroyables. Elle a tapé contre un mur à genoux, avec les deux mains, avec raquette à gauche, à droite, avec plusieurs balles, en jonglant, en sautant, en employant des jeux d’adresse. L’enseignement des petits était sans doute le secteur que je n’avais pas abordé, elle m’a poussée à y réfléchir. Les enfants ont changé, ils ne veulent plus être compétiteurs à tout prix, ils veulent jouer. Elle voulait me montrer comment il fallait jouer et je l’ai laissée faire. Il faut que l’on change notre approche sur cette nouvelle génération qui fait tout plus que tout, qui ne souhaite pas de challenge de compétiteur one to one mais qui veut jouer en équipe. A nous sans doute de redonner sa place au jeu de double, à retrouver le plaisir de jouer en famille, de partager des choses à plusieurs. Il m’arrive de faire des confrontations où ils sont 4 contre 4 . Parfois aussi je me dis "Pourquoi ne fait-on pas que des lobs? Pourquoi n’apprend t-on pas le lob à 6,7 ans. J’ai déjà joué sur deux terrains côte à côte avec un filet plus haut sur l'un des deux pour travailler le lob au-dessus du grillage. J’ai remis le lance-balles au goût du jour qui amène de la gaité. Ce n’est pas le coach, ce n’est pas un lancer ; c’est une improvisation d’un lancer et c’est rigolo.
Pour en revenir à ma fllle, elle a peut-être envie de devenir prof. Sa maman a un magasin de crocodiles et de chemises lacoste, elle veut aussi tenir ce magasin. On verra bien plus tard. C’est une sportive, elle est sagittaire. Elle a plein d’idées ; elle est merveilleuse….
Agnès Figueras-Lenattier
10:27 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tennis, traumatisme, confessions
dimanche, 07 novembre 2021
Docteur Virot

Psychiatre, le docteur Virot a tout de suite débuté en pratiquant l’hypnose. . « Lors de mes études, expliqiue t-il, on me proposait en gros deux voies thérapeutiques : soit je devenais marchand de médicaments, soit je faisais de la psychanalyse. Ces deux voies ne me plaisaient guère, et ce n’est pas ainsi que je concevais mon métier. Concernant les médicaments, je pensais que les gens avaient d’autres ressources. Quant à la psychanalyse, cette discipline ne m’intéressait pas tellement car elle me semblait trop lente, trop floue. Je voulais trouver quelque chose de pragmatique, d’efficace et c’est à ce moment là qu’est apparue la première formation d’ypnose ericksonienne en France à laquelle j’ai participé. Lorsque l’on commence comme médecin, on a le droit car c’est très réglementé d’aller donner sa carte de visite à des confrères. Et sur ma carte j’ai mis Hypnose éricksonnienne ». Ce qui a beaucoup inquiété mes professeurs qui m’ont dit « Il ne faut pas le dire, ni annoncer des choses comme ça, tu vas avoir des soucis ». En 1988, personne ne faisait de l’hypnose. Mais je pense que cette initiative a fait partie de mes bonnes idées. Egalement de faire ma thèse sur l’hypnose car j’étais reconnu par la faculté. Dans un livre didactique et très complet intitulé « Hypnose, et auto-hypnose « aux éditions Robert Laffont, il explique les diverses particularités de l’hypnose ainsi que son histoire.
Vous pratiquez l’hypnose ericksonnienne. Y en t-il d’autres ?
Pas vraiment si ce n’est l’hypnose classique, celle de Charcot. On l’enseigne toujours à l’Institut français d’hypnose. Mais quand est arrivée l’hypnose ericksonienne , c’est comme si on avait lancé des graines sur tout le pays de la France et elle s’est étendue partout. De même dans d’autres pays. Quant à l’hypnose classique, quelques personnes la pratiquent encore mais très peu. Englobant des suggestions plus directes, plus autoritaires, elle peut être intéressante sur certaines personnes mais c’est très marginal.
Dans votre livre vous dites que l’hypnose à orientation médicale et thérapeutique est née à l’époque de la révolution française. Pourriez-vous préciser dans quelles circonstances ?
Alors que beaucoup de gens étaient à l’époque un peu occultistes, Mesmer médecin autrichien prétendait pouvoir soigner des gens à distance sans contact direct. Mais c’était en totale opposition avec toutes les logiques matérialistes. Il fallait soit toucher les gens, soit donner des médicaments, des aliments, ou faire des saignées ou des purges. Il a présenté sa méthode au sein des sociétés viennoises médicales mais il s’est fait traiter de tous les noms On a dit que ça n’avait pas de sens, que c’était impossible. Mesmer en réaction a commencé alors à prétendre qu’il existait quand même un support matériel : un fluide animal dans l’éther avec des espèces de petites particules qui se transmettent qu’il était capable de capter. C’était assez sulfureux et il s’est fait virer de Vienne. A ce moment là, il régnait une atmosphère frémissante à Paris et il existait des ferments importants sur le plan social, politique, religieux, philosophique. La tendance notamment chez les philosophes des lumières était une ouverture aux idées et aux expériences nouvelles dont le fait de transmettre le savoir et de le partager. Or à l’époque celui-ci était destiné aux riches. Toute une dynamique interne à la France qui permettait de proposer quelque chose de nouveau aussi dans la médecine.
Mesmer à Paris
Mesmer est donc venu à Paris avec ses pensées et ses hypothèses et il a été bien accueilli. Il a obtenu un large succès avec les malades et a donc retenu l’attention autour de lui. Deux enquêtes ont été réalisées diligentées par ce qu’on appellerait aujourd’hui le Ministère de la Santé sous l’autorité du roi. Ils ont cherché ce fameux fluide mais n’ont rien trouvé. Là encore on a parlé de foutaise, de charlatanisme. Il a été dénigré une fois de plus. Mais les scientifiques ont pu vérifier que beaucoup de gens étaient guéris et ont émis dans leur rapport officiel d’ailleurs consultable la théorie de l’imagination. Une porte ouverte sur un nouveau monde puisque jusqu’à présent l’imagination et les corollaires comme l’impalpable, le magique, le mystique se situaient dans le monde de la religion, de la croyance. Or tout d’un coup il pénètre dans le monde médical ce qui n’était pas prévu. Ce principe a été repris, développé et l’on a fini par penser que l’imagination constituait une dimension naturelle de tout être humain et qu’en l’activant, on pouvait aller mieux et même guérir.
Comment le concept de l’imagination a-t-il évolué ?
Ll’imagination va petit à petit devenir l’inconscient et de nombreuses théories sur l’inconscient vont être élaborées tout au long du XIXè siècle. Pour finir dans les mains de Freud avec sa théorisation un peu complexe. On a l’habitude de dire que l’hypnose naît en France à peu près en 1900. Un premier congrès mondial d’hypnose se déroule à Paris en 1889, un deuxième aussi en 1900. Dans toutes les écoles du monde ; on apprend que la France est le berceau de ce domaine. Puis à partir de 1900, plus rien. On affirme qu’avoir recours à cette méthode n’est pas sérieux, pas nécessaire, pas prouvé. Et on en revient aux modèles purement matérialistes de la médecine. Le modèle neurologique, l’infectiologie reprennent le dessus, Pasteur passant par là. Entre temps Charcot a perdu la partie. Il s’est intéressésé à l’hypnose pendant une vingtaine d’années ce qui a donné de l’essor à cette branche. Il a voulu trouver une théorie neurologique de l’hypnose, trouver un support matériel mais en vain. Puis cette hypnose qui avait carrément disparu en Europe s’est un peu installé aux Etats-Unis notamment par le biais d’un médecin Clark Hull dont Erickson était l’élève. Aujourd’hui, on dit que l’hypnose est très créative, imaginative, personnalisée mais à l’époque elle était très standardisée et tout le monde était soigné de la même manière.
Erickson s'oppose à Clark Hull
C’était ainsi que travaillait Hull qui se basait sur les premiers enregistrements en train de se mettre en place et qui pensait que cela suffisait pour permettre aux patients d’aller bien. C’est ce qu’on appelait l’hypnose directive, aujourd’hui appelée hypnose classique qui comprenait beaucoup de déchets et finalement ne convenait pas à grand monde. Elle ne prenait pas en compte l’histoire de chaque personne, son histoire, ses valeurs, ses émotions, sa constitution interne. Cela n’a pas du tout plu à Erickson qui pensait au contraire que les ressources hypnotiques, l’imagination étant très personnelles, il fallait s’adapter à chacun. C’est de cette manière qu’il a emprunté un chemin original et très controversé mais il a fini en pleine gloire.
Vous disiez que lors de la première consultation, il ne faut pas faire d’hypnose !
Je compare toujours l’hypnose à de la chirurgie. J’ai failli être chirurgien, c’est peut-être la raison… Ainsi, avant de faire un acte majeur de soin, on fait d’abord une évaluation, une espèce de check up pour mieux connaître le patient, la raison de sa venue, qui il est. Vous imaginez aller à une consultation chez le chirurgien qui dès la première visite vous opère sur le coin de la table. Pas sûr que cela vous plairait. Pour l’hypnose, je pense que c’est le même principe. Il y a aussi une autre dimension qui consiste à penser qu’il est intéressant d’en faire mais intéressant aussi de ne pas en faire.
Justement comment décidez-vous d’y avoir recours ou pas ?
En voyant les gens. J’ai vu un monsieur qui a une pathologie un peu spéclale, la maladie des jambes sans repos. Quand il veut se reposer et particulièrement quand il veut dormir, son corps s’agite et en particulier ses jambes. Elles bougent tout le temps. Il a ce symptôme là depuis très longtemps. Quand il est venu, il m’a demandé de le revoir au bout de 15 jours et m’a demandé si l’on ferait de l’hypnose. « Je ne sais pas" lui ais-je répondu ce qui l’a surpris. « Si vous allez bien dans 15 jours ais-je ajouté, je ne vais pas en faire avec vous, donc je ne sais pas »… Une première rencontre comme j’ai fait avec cet homme, c’est très thérapeutique et des changements peuvent se produire car il a pris la décision de venir. Très régulièrement, je vois lors d’une première séance, des patients souffrant de douleurs éparses, de troubles du sommeil, d’anxiété et qui reviennent en me disant « C’est bizarre, ça va mieux ». Je leur explique alors que ce n’est pas la peine d’avoir recours à l’hypnose. S’ils continuent à aller suffisamment bien et que ça évolue favorablement, je ne les vois plus.
Vous êtes doué alors !
Non, ce n’est pas la question. Il existe beaucoup de techniques lors d’une première rencontre, et un grand travail à élaborer. C’est une séance très complexe, la plus complexe de toutes. Certaines personnes qui décident de prendre rendez-vous avec un médecin vont déjà mieux avant même de l’avoir vu. C’est placebo d’une part, et c’est aussi parce qu’ils se sont mis en route vers un processus évolutif. Mais parfois c’est vain et il y a quand même beaucoup de gens avec qui je fais de l’hypnose.
Uniquement de l’hypnose ou aussi de la psychothérapie ?
Oui j’en fais, bien sûr. D’ailleurs, certains patients quand ils viennent ne savent pas de quoi ils ont besoin. C’est toujours le thérapeute qui sait. Souvent, ce qui leur fait du bien c’est de parler avec quelqu’un, donc des séances de psychothérapie. Je peux faire des thérapies de groupe, des thérapies familiales et aussi des thérapies brèves.
Vous insistez beaucoup sur la respiration !
C’est un processus corporel très important. Il existe de nombreuses personnes à qui il suffit d’apprendre à respirer pour qu’ils aillent bien. C’est d’ailleurs étonnant comme il faut peu de choses parfois pour soulager. Je vais vous raconter une histoire récente. Une dame vient me voir qui a des douleurs dans le mollet, au- dessus de la jambe droite. J’ai utilisé la technique de thérapie brève en lui demandant de faire des choses un peu bizarres. Je lui ai suggéré de trouver chez elle une grande chaussette qu’elle mettrait tous les soirs sur sa jambe gauche, et tous les soirs de placer deux pièces de monnaie sous la chaussette à chaque fois à des endroits différents. Elle l’a fait pendant 15 jours . «Au début m’a-t-elle expliqué ça m’embêtait , mais n’empêche que depuis 10 jours, je ne souffre plus ». Je lui ai dit « Vous allez bien rentrez chez vous »
Vous faites très attention aux mots et aux émotions du patient !
Oui, les mots sont très importants, c’est tout le cœur d’une première rencontre. C’est aussi le cœur de toutes les formations, apprendre à communiquer. On a deux dimensions de l’inconscient qui n’ont pas le même langage. Celle que l’on utilise avec une connotation un peu négative. Des mots comme douleur, peur, tristesse qui fabriquent de la tristesse, de la peur ou de la douleur. Effectivement, plus vous parlez de douleur, plus vous avez mal. Que fait-on dans les hôpitaux ? On ne parle que de douleur tout le temps, on l’évalue à longueur de journée. . On a une deuxième dimension de l’inconscient qui s’appelle la conscience virtuelle et qui prend tous les mots de manière littérale. Si elle entend le mot colère, douleur, elle fabrique tout ça. Quelle est celle qui prend le dessus sur l’autre ? Cela dépend de l’état émotionnel dans lequel on est. Si on va bien ça va mais quand on va voir un soignant c’est parce que l’on ne va pas bien, donc on se retrouve très vite dans une transe d’alerte, une transe négative. Et dans une transe, c’est la conscience virtuelle qui prend le dessus. L’on est alors beaucoup plus sensible à tous les mots que l’on utilise. Chaque mot, chaque geste va avoir une importance. Je fais très attention à mon langage, cela s’appelle la communication thérapeutique. Il faut apprendre à maîtriser le langage, et dans mon institut d’enseignement on y a beaucoup recours. D’ailleurs, les gens s’y intéressent de plus en plus. En médecine on n’apprend pas à utiliser le langage verbal, l’intensité de sa voix, son rythme, ses gestes.
A-t-on observé le cerveau avant et après une séance ?
On l’a observé avant et pendant une séance. Beaucoup d’études sur le sujet extrêmement importantes ont été réalisées entre 1997 et 2000. Elles ont montré que le cerveau ne fonctionne pas pareillement lors d’une séance ou dans un état de conscience ordinaire. Les images montrent des zones du cerveau plus actives et d’autres moins actives. Cela a permis de valider le fait que l’hypnose a un impact mais les connaissances sur la conscience sont très parcellaires aujourd’hui.
Pourriez-vous décrire une séance ?
Beaucoup de gens pensent que toutes les séances se ressemblent mais il existe plein de formes d’hypnose différentes. Quand je reçois un patient, j’ai un catalogue de 20 ou 25 techniques. Mais voici la classique, celle que l’on enseigne : Je demande au patient d’imaginer mentalement un endroit où il se sent bien, comme par exemple être au bord de la plage. Je vais employer cette technique avec un patient qui m’affirme ne pas être bien, qui est anxieux, tendu, enfermé dans ce malaise. Il peut aussi me dire quelque chose qu’il aime faire, du vélo, du ski, de la cuisine. Il va aussi me décrire la météo, les gens avec qui il aimerait être. Je vais recueillir ses propos, on appelle cela recueillir un thème. Je vais l’aider à se dépasser mentalement, à emporter sa conscience ailleurs. Quand on arrive à imaginer suffisamment fort et pendant un certain temps, un effet régulateur se fait sentir sur tout le monde intérieur du patient.
Parfois vous employez des techniques mixtes. A la fois médicaments et hypnose ?
J’ai fait cela quand je me suis installé en 88. Je prescrivais des médicaments. Soit je ne faisais que cela, soit je ne prescrivais rien avec de la psychothérapie.. Il m’arrivait d’avoir des médicaments dans une main, et d’avoir recours à l’hypnose dans l’autre. Cela ne marchait pas terrible, donc j’ai arrêté les médicaments au bout de 10 ans. Par rapport aux dépressions, je considère qu’il y en a 90% qui s’améliorent pas rapport à un diagnostic précis. Et dans ces 90% assez rapidement il n’y a plus plus besoin ni de psychiatres, ni de médicaments. Des échecs complets, je dirais 10%.
Et avec les patients qui prennent des médicaments notamment des neuroleptiques peut-on agir efficacement ?
On peut très bien travailler avec des patients psychotiques. Ca va les aider mais il faut être un expert de la psychose, au moins psychologue ou psychiatre . C’est un trouble de la conscience extrêmement complexe donc il faut avoir l’habitude de s’y investir. Les neuroleptiques sont faits pour figer la conscience alors que l’hypnose est faite pour faire bouger la conscience. Ce sont des faits qui se contredisent . Comme les neuroleptiques vont bloquer essentiellement la conscience virtuelle, cela provoque un certain apaisement.. La conscience ne part pas dans tous les sens. Donc l’hypnose et ces médicaments là,, ne sont pas très amis… Maintenant, je vois des jeunes qui ont des troubles psychologiques récents. Avec eux, on va pouvoir éviter des aggravations de psychose. Avec aussi des psychiatres et des institutions qui veillent sur eux et qui contrôlent un peu leur état. Mais il y a des psychoses multiples de niveau, 1,2, 7,8…On peut aider à peu près tout type de patient car il a en lui des capacités pour améliorer sa conscience, à trouver des solutions. A changer sa manière de voir la vie, de modifier ses sensations corporelles, ses émotions. On peut faire beaucoup de choses avec beaucoup de gens.
Peut-on expliquer d’où proviennent ces échecs ?
La plupart viennent de l’incapacité du thérapeute, de ses limites à comprendre, à aider et à s’intégrer dans le schéma mental du patient. Cela demande beaucoup de souplesse, d’attention, d’expérience. Pour les dépressions par exemple, il existe pratiquement autant de dépressions que de patients. Il y a les légères et les récentes et d’autres extrêmement violentes, anciennes et modérées, ou anciennes et très complexes. Des contextes de vie un peu tordus dans tous les sens, des expériences traumatiques, de décès, de violence. C’est mon parcours et il est corroboré par mes collèges. Au début quand on fait des soins on arrive à soigner des dépressions relatives et légères mais c’est plus compliqué pour les pathologies complexes. L’expérience est nécessaire pour s’intégrer, pour entrer en résonance et synchronisation avec le patient. Il faut arriver soi-même à se modifier intérieurement avec chaque patient. C’est pour cette raison que la première rencontre est primordiale. A l’époque, je faisais deux, trois séances avec les patients avant histoire d’être suffisamment accordé avec eux.
L’âge rentre t-il en ligne de compte ?
Ce n’est pas tellement une question d’âge même si cela a quand même une importance.. Il va intervenir dans la capacité ou non d’établir une relation durable avec un interlocuteur. Quelqu’un de très âgé qui a des troubles de type alzheimer possède une conscience très fluctuante, fragmentaire, floue. Cela peut devenir compliqué avec des troubles de l’attention, de la mémoire. Je peux par exemple m’occuper de dépressions extrêmes mais pas de patients de type Alzheimer. Je n’ai pas cette expérience là. Avec les enfants dont la conscience fonctionne différemment, il faut là aussi des capacités d’adaptation. Il faut apprendre encore et encore. Pour le nombre et l’espace entre les séances, pas de règles vraiment de règles. Là aussi c’est adapté à chaque personne. Cela dit,. si je vois une personne une première fois, la fois d’après ne dépassera pas un mois car l’effet peut disparaître. . Il faut savoir que des personnes aux cas très compliqués peuvent évoluer très vite alors qu’au contraire des patients aux troubles moins compliqués vont curieusement demander plus de travail. Chacun d’entre nous à un moment donné dispose de ressources , de capacités qui peuvent se mettre en route. Même face à des troubles assez importants… Les médecins classiques n’aiment pas du tout ce genre de discours, mais pourtant c’est ma vérité quotidienne depuis 30 ans.
Et l’’hypnose lors d’opérations ?
Quand j’ai découvert cette possibilité, cela m’a fasciné et ça me fascine encore. J’ai le souvenir de la première fois où je suis allé dans un bloc opératoire et qu’une patiente était opérée non anesthésiée de manière habituelle. Cela m’a impressionné et démontre qu’il existe de sacrées compétences dans la nature humaine pour faire face à des situations complexes. Mais ces compétences là ce n’est pas toujours facile de les utiliser seul, il faut être aidé. C’est pour cela que les anesthésistes et le personnel se forment. Toute une technique relationnelle va être utilisée. Même l' hypnose n'est pas utilisée durant l’opération, une séance faite juste avant va permettre aux gens de s’endormir, et de rentrer en anesthésie générale de manière plus paisible, plus tranquille. Avec un réveil plus serein et plus confortable…
La profession n’est pas réglementée !
`C’est effectivement un gros souci car n’importe qui peut se proclamer hypnothérapeute. On a fait une étude qui a révélé que 90% des gens ne savent pas faire la différence entre un professionnel de santé et quelqu’un qui n’a pas de compétence autre que d’avoir fait une formation en hypnose. Les gens ont parfois des troubles simples, mais parfois cela peut être beaucoup plus grave et si on n’a pas un volume de compétences suffisant, on n’a aucune chance. Soit les symptômes vont s’aggraver, soit les soins vont être retardés, soit ils vont conclure que l’hypnose n’est pas efficace. Aujourd’hui c’est à tour de bras que les gens s’installent pour gagner leur vie avec l’hypnose. La reconnaissance par l’OMS a été arrêtée à cause du Covid mais des processus sont en cours. On a mis en place un annuaire spécifique des professionnels de santé « L’hypnose santé « pour orienter les gens vers des professionnels qui ont des bagages vraiment solides…
Agnès Figueras-Lenattier
13:13 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hypnose, livre, explications
mercredi, 03 novembre 2021
Amélie Oudéa-Castéra
 Actuelle directrice générale de la fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra a été championne du monde des moins de 14 ans en 1992, et 18ème joueuse française. Après une brève carrière dans le tennis, elle a bifurqué dans une autre vie en entamant de brillantes études ( Sciences Po, Essec,, Ena), puis a travaillé au sein de grands groupes comme Carrefour, Axa. Elle a été élue femme digitale de l’année 2020. A l'occasion du Rolex Paris Masters 2021, elle se confie sur sa politique tennistique :
Actuelle directrice générale de la fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra a été championne du monde des moins de 14 ans en 1992, et 18ème joueuse française. Après une brève carrière dans le tennis, elle a bifurqué dans une autre vie en entamant de brillantes études ( Sciences Po, Essec,, Ena), puis a travaillé au sein de grands groupes comme Carrefour, Axa. Elle a été élue femme digitale de l’année 2020. A l'occasion du Rolex Paris Masters 2021, elle se confie sur sa politique tennistique :
Vous avez fait quelques années sur le circuit professionnel de tennis, une vie qui finalement n’était pas faite pour vous. Vous n’étiez pas heureuse !
C’est vrai. A 18 ans, j’ai senti que mon bonheur serait plus important ailleurs. Sur le circuit pro, c’est parfois très austère , très solitaire avec beaucoup d’attente dans les avions, les gares, les aéroports, les chambres d’hôtels. Une vie faite aussi de beaucoup de rivalité, parfois de jalousie et le sport de haut niveau, la haute performance ne compensait plus ces aspects qui me faisaient davantage souffrir. Et à l’occasion d’une blessure qui m’a empêchée de bien jouer ces mois-là, je me suis dit qu’il fallait finalement que je boucle un peu cette première vie dans le sport de haut niveau et lle tennis pour aller en conquérir une deuxième dans un environnement plus équilibrant : études, copains, classe, émulation et ouverture intellectuelle plus forte.
Vous avez été la compagne de Gustavo Kuerten lorsqu’il a gagné Roland Garros en 1977. Avez-vous quelques recettes à nous donner concernant la manière dont doit se comporter une compagne pour faire gagner un grand Chlem ?
En fait, c’était une situation et un contexte très atypique, car je le connaissais du circuit junior. On s’était rencontrés quand on avait 14 ans, on avait beaucoup sympathisé, on avait eu une petite histoire d’adolescents quand j’avais 15 ans et demi, 16 ans. Or quand j’ai arrêté Roland Garros l’été qui a suivi ma décision d’arrêter, c’était très difficile de ne pas y participer et pas possible pour moi. Pour combler ce manque, j’avais candidaté pour contribuer à l’organisation du tournoi. Le directeur général de l’époque Gilbert Ysern m’avait alors proposée un petit job au planning des courts, la gestion des balles, la relation avec les joueurs. C’est là que j’ai retrouvé Gustavo que je n’avais pas vu depuis environ 2,3 ans et on a très vite reconnecté, sympathisé. On s’est revus au fil de la quinzaine, et de plus j’étais proche de son entraîneur Larri Passos. De fil en aiguille Gustavo et moi avons discuté, pris un verre ensemble, puis son entraîneur m’a proposé de venir dîner avec eux. Et cette petite histoire d’adolescents a repris au fil du tournoi, même si Gustavo était extrêmement concentré sur sa réussite. Mais c’était justement très bien. Je participais au tournoi d’une manière différente, et je pouvais suivre son épopée au jour le jour.
Une brasserie nommée " Victoria"
Nos petits rendez-vous qui consistaient à se retrouver dans une brasserie intitulée Victoria, la bien nommée… du boulevard Victor tout près de chez moi étaient devenus un petit rituel porte-bonheur. C’était merveilleux avec des moments de bonheur volés à droite et à gauche pour égayer le quotidien et se donner une forme de petit cocon de douceur dans ce monde très compétitif. Une sorte de petit dérivatif…
Lorsque vous avez bifurqué vers une autre vie avez-vous gardé un pied dans le tennis ?
Le tennis était complètement dans mon ADN, j’ai été constituée par lui. En effet, je suis née dans une famille de passionnés de tennis, toute ma famille joue et c’est un élément extraordinairement important pour nous tous culturellement. Donc il était impensable que je coupe vraiment avec ce sport. J’ai arrêté de jouer en compétition, mais j’ai toujours maintenu un lien avec certains amis du monde du tennis. Et puis, j’ai toujours été membre d’un club, d’abord au TCP puis au Racing, puis les deux. J’y allais de temps en temps pour avoir le bonheur de taper un peu la balle ou de prendre un verre avec des personnes après une bonne séance de gymnastique. En outre, j’ai toujours maintenu un lien avec l’institution fédérale elle-même. En 1997, je me suis occupée d’un groupe de travail sur la reconversion des sporifs de haut niveau. M’a ensuite été proposée de faire partie d’une commission fédérale sur l’éthique. Je suis également entrée pendant un moment au Comité directeur de la Fédération sur l’initiative de Jean Gachassin alors président de la fédération et de Gilmbert Ysern. Cela m’a permis de m’investir dans cet objet fédéral, de continuer à me tenir au courant des politiques tennistiques à la fois localement et au niveau central. J’ai beaucoup apprécié de garder ce lien avec les élus et les équipes fédérale
Maintenant que vous êtes directrice générale de la Fédération, quels sont vos divers objectifs ?
On se dit souvent avec Gilles Morreton, l’actuel président que l’on a 5 +2 objectifs.
Le premier c’est de bien organiser nos grands événements notamment Roland Garros et le tournoi du Rolex Paris Masters 1000 du circuit ATP.
Le deuxième objectif c’est tout ce qui a trait au haut niveau. Comment aider la direction technique nationale à essayer de vraiment relancer le tennis français. Et de partir à la conquête de la haute performance que ce soit dans l’éducation et la formation des jeunes dans les territoires ou après dans leur formation vers l’élite avec tous les compartiments que cela peut représenter := préparation tennistique mais aussi tactique, technique, mentale, médicale. Faire des champions de demain et permettre à nos espoirs de libérer tout leur potentiel. Le 3ème objectif c’est le développement de la pratique dans les territoires pour les familles, les enfants, un peu pour toutes les couches de la population. On a l’habitude de dire que le tennis est le sport de toute une vie. Cela commence à 2,3,4 ans jusqu’à un âge très avancé. Notre doyenne a aujourd’hui plus de 100 ans. Avec également le développement du padel avec comme leader Arnaud Di Pasquale. C'est une discipline dont s’occupe la fédération depuis 2014.
Une seule femme présidente de ligue
Le 4ème objectif vise les enjeux transversaux sociétaux : la lutte contre le dopage, la corruption, les paris sportifs manipulés. Egalement tout ce qui a trait à la gouvernance et le fait de féminiser les instances dirigeantes de la fédération un peu à tous les niveaux de responsabilité. Aujourd’hui on n’a qu’une seule femme présidente de ligue et faire accéder plus de femmes à des responsabilités dans la vie fédérale est donc quelque chose auquel on est très attaché. Le 5ème thème a pour but la modernisation de notre modèle économique. C’est là que rentre le fait d’organiser dans le stade Roland Garros toute une série d’événements culturels, de divertissements dans des secteurs comme la gastronomie, la mode. Mais aussi d’autres événements se rapportant à d’autres sports. Ainsi a-t-on organisé récemment une compétition de boxe et un événement pour la fête de la musique.. On essaye de développer l’utilisation du stade au-delà du tournoi pour diversifier nos recettes. On a en plus monté un fond de dotation, sorte de mini-fondation au sein de notre fédération pour essayer de lever des fonds. Y compris en terme de mécénat pour derrière renforcer les moyens que nous avons pour accompagner les associations par exemple en matière de prévention des abus sexuels. Toutes ces thématiques transversales alimentées par ce fond de dotation.
Et puis pour finir le +2 que j’ai évoqué au début : D’abord l’influence et la présence de notre fédération au niveau de la gouvernance internationale du tennis. Avec les autres tournois du Grand Chlem et les tours que sont L’ATP et la WTA qui représentent les joueurs et joueuses nous avons plein d’enjeux communs , afin d’essayer de pousser le rayonnement du tennis à l’international en engageant notamment davantage la communauté des femmes. Enfin, nous nous attachons à développer une bonne gestion humaine de notre fédération. Je suis actuellement à la tête d’une équipe de près de 470 personnes et je veux qu’ils soient heureux, épanouis et très engagés dans leur mission au quotidien
Vous croyez beaucoup à l’approche multi sports pour faire vivre les clubs !
Absolument ! On vit aujourd’hui dans une société où il existe des sports qui font beaucoup de bien comme les pilates ou le yoga. Ce sont des activités devenues importantes dans la vie des femmes car ça permet d’apprendre à mieux respirer, à être davantage à l’écoute de son corps, de compenser des vies parfois trop sédentaires qui peuvent faire naitre des problèmes de dos, aux articulations. Et je pense que de marier ces disciplines là avec le tennis dans les clubs, avec des cours de gym, des animations musicales fait partie de la façon dont les gens ont envie de faire du sport. De bouger en rythme, d’avoir en même temps des instants de vrai calme et d’être un peu sur tous ces accords de manière un peu continue concentrés en un seul endroit afin de pouvoir passer de l’un à l’autre. Depuis 6 mois, je fais moins de pilates,, mais j’en ai fait très régulièrement ces dernières années. En revanche, le yoga est devenu un élément de ma vie quotidienne et je ne commence pas ma journée sans en faire un petit peu. Ca m’apporte énormément.
Vous disiez vouloir féminiser les instances fédérales. Etes-vous par exemple en pourparler avec de grandes championnes ?
Oui, on essaye de vraiment nous appuyer sur nos anciennes championnes. Cela nous fait un peu râler quand on nous dit que depuis Noah il n’y a pas eu de champion français. On a eu trois championnes qui ont gagné un voir plusieurs Grands Chlems : Amélie Mauresmo, Mary Pierce et Marion Bartoli. On cherche à travailler avec elles et c’est pour nous un élément de mentoring que l’on voudrait pouvoir donner à nos jeunes joueuses. On veut comprendre ce que ça implique de gagner un. Grand Chlem de l’intérieur. Leurs enseignements peuvent être super précieux pour la jeune génération. Saisir les exigences du haut niveau, les émotions, comment apprendre à les gérer ? Qu’est-ce que tout cela représente. Ces conseils et cette transmission ont trop souvent manqué par le passé et on veut réussir cette fois-çi. Oui on est en discussion avec les trois et puis dans la perspective des JO de 2004 cette action de mentoring sera vraiment importante à mettre en place pour nos joueuses mais peut-être aussi pour nos joueurs. Nous discutons d’ailleurs avec des joueurs comme Pioline.
Que comptez-vous faire pour le padel
On a un plan de développement très complet avec notamment l’accélération des équipements des clubs. On était récemment Arnaud Clément et moi avec le président de la République pour l’annonce du grand plan de développement des équipements sportifs de proximité par lequel l’Etat va co financer 500 nouvelles pistes de padel à l’horizon 2024. Ce volet équipement est très important car on a aujourd’hui 245.000 pratiquants dont 130.000 pratiquants réguliers. Mais qui ne se partagent que 955 pistes de padel sur l’ensemble de la France. Ce qui représente une piste pour 120, 130 pratiquants réguliers. Alors qu’en tennis il y a un court pour 25 joueurs. Il faut donc combler ce retard et ce soutien de l’Etat va beaucoup nous aider. Un autre volet est celui de la formation, de la création d’écoles de padel, du repérage de jeunes talentueux avec en perspective des délégués inter régionaux. Nous souhaitons nous rapprocher du Word padel tour au niveau de la fédération internationale pour essayer de créer des compétitions innovantes au plus haut niveau. Enfin nous voulons bien faire connaître cette discipline et l’on a développé un guide du padel expliquant les caractéristiques et les exigences qu’elle implique. Par le biais d’une plus forte communication nous allons accompagner l’essor incroyable de cette discipline hyper ludique, très accessible et joyeuse..
Et pour le tennis en fauteuil ?
On fait déjà beaucoup de choses en essayant d’accompagner le mieux possible les clubs et les structures ; pour faire connaître cette discipline y compris à travers nos relations avec l’éducation nationale. Avec un dispositif comme le pass sport, accessible aux jeunes enfants souffrant d’un handicap, on arrive à les faire s’intéresser au tennis. On fait en sorte de développer davantage de compétitions avec des enfants sourds ou malentendants pour que cela puisse vraiment créer du lien social. A Roland Garros on a des compétitions en tennis fauteuil et puis de quad que l’on souhaiterait faire monter en puissance dès la prochaine édition de Roland Garros. Il faut que cela permette de montrer le côté inspirant des grands champions. On a par exemple des joueurs comme Stéphane Houdet et Nicolas Pfeiffer qui ne l’oublions ont gagné la médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Tokyo. C’est un énorme exemple pour nous de les voir se battre avec autant de courage et d’avoir su au mental gagner cette performance…
Pour finir avez-vous une explication sur le fait qu’en France nous avons des jeunes filles et des jeunes garçons qui gagnent souvent les championnats du monde juniors ou autres et qui après n’ont pas les résultats que l’on escomptait ?
Il y a plusieurs explications. D’abord une raison un peu culturelle : En France on a parfois un petit peu tendance à vouloir que l’on dise de nous que l’on a du potentiel, que l’on est talentueux plutôt que de dire qu’un joueur ou une joueuse a la gagne. Ce côté un peu romantique, un peu dans le panache plus que dans l’obsession de la victoire jusqu’au dernier centimètre est parfois un trait de caractère un peu français. Il faut du reste que l’on se batte contre cette réalité car comme le dit une célèbre marque « Seule la victoire est belle ». C’est quelque chose qu’il faut retenir… Autre raison : On a une belle densité de compétition en France au début du circuit sénior et chez les juniors et quelquefois l’âpreté du circuit professionnel requiert un mental pas suffisamment aguerri, affûté chez nos jeunes pour vraiment serrer les dents, tenir et être rivé coûte que coûte sur sa passion pour le jeu. La mise en place à la DTN au niveau du pôle de préparation mentale des territoires et de filières de formation est quelque chose de très important. Enfin, je pense qu’il existe un facteur générationnel.
L'effet de grappe
On a eu il y a peu ,une génération extraordinaire avec les Gasquet, Monfils, Tsonga, Simon qui étaient vraiment dans un mouchoir de poche et qui se sont tirés vers le haut les uns les autres. J’appartiens à une génération où il y avait Mauresmo, Nathalie Dechy ; Emilie Loit, Anne-Gaëlle Sidot, Amélie Cocheteux, un vrai petit groupe d’élite à un moment donné. Selon moi, survient un effet de grappe. Quand il y en a un ou une qui commence à sortir la tête de l’eau, cela montre aux autres que c’est possible. Se développe alors un effet hyper stimulant du champion en train d’émerger. tous y croient à leur tour et ils se tirent la bourre au bon sens du terme. Nous sommes actuellement dans un moment de creux qui ne génère pas cette émulation mais cela peut changer très vite. On l’a d’ailleurs vu avec le dernier US Open avec les trajectoires fulgurantes de Leylah Fernandez et d’Emma Raducanu. Si on lève un certain nombre de difficultés, de freins pour accélérer le développement de la joueuse ou du joueur , cela fait surgir un effet d’entraînement qui peut emmener toute une génération au meilleur niveau…
Agnès Figueras-Lenattier
16:49 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fédération, tennis, objectifs
dimanche, 31 octobre 2021
Ping 4 Alzheimer, association destinée aux malades Alzheimer

Voici la liste de ce qu’apporte le ping-pong selon ce médecin :
-Il augmente la concentration et la vigilance
-Il stimule la fonction cérébrale
-Il développe des compétences de pensées tactiques
-Il développe la coordination main/œil. La vitesse, la rotation et le placement de la balle sont des éléments cruciaux au tennis de table. Sa pratique nous amène à gérer rapidement ces trois facteurs.
-Il constitue une activité physique aérobie
-Il permet une interaction sociale et récréactive.
Selon un autre médecin, le Docteur Wendy Suzuki, professeur de neurosciences à l’Université de psychologie de New York, le ping-pong améliore les fonctions motrices, les capacités à élaborer la stratégie, et les fonctions de la mémoire à long terme.
Trois grands domaines sont touchés : le contrôle de la motricité fine et la coordination œil-main qui sollicite et développe le cortex primaire et le cervelet, les zones responsables des bras et des mouvements de la main…
Stimulé par ces affirmations et ayant été touché de près par la maladie d’Alzheimer, son grand-père en ayant été atteint, Renato Walkowiak professeur de ping-pong depuis 25 ans (en photo sur la première image) a créé avec une psychologue et un kiné une association intitulée Ping 4 Alzheimer destinée à faire faire du ping-pong aux malades d’Alzheimer. Voici son témoignage :
Pourriez-vous expliquer comment est né Ping Four Alzheimer ?
Mon grand-père a eu la maladie d’Alzheimer lorsque j’avais 15,16 ans et j’ai pu constater les dégâts que cela provoquait chez une famille. Puis en 2015, j’ai vu passer une étude au Japon sur les bienfaits du ping-pong sur le cerveau. Les chercheurs avaient fait de l’imagerie mentale et découvert que 5 zones du cerveau étaient stimulées pendant la pratique du ping-pong et dans le sport en général. Ce constat a ensuite été confirmé par le King’s Collège à Londres qui a également effectué une phase d’imagerie mentale sur un groupe de personnes qui allaient jouer au ping-pong. Ils se sont rendu compte que l’hippocampe grossissait, une région du cerveau qui rétrécit en cas de maladie d’Alzheimer. Le ping-pong a aussi été mis en avant par quelques neurologues américains comme les docteur Amen et Suzuki comme le sport stimulant le plus le système cognitif. Il existe une densité de stimulation intéressante et la partie visio-spatiale est aussi grandement développée en terme de coordination, motricité et sur le plan de la proprioception par rapport à l’activité que l’on pratique. Suite à ces informations, j’en ai parlé à un kiné du club et à une psychologue pratiquant le ping-pong en compétition et en 2018, nous avons mis en place cette association d’abord au club de Levallois où je travaille. Le plus grand club de ping-pong d’Europe. Le kiné a beaucoup travaillé sur ce qu’il fallait mettre en avant ou pas. On a essayé de se polariser sur des exercices simples pour mettre les patients en confiance avec avant une partie dédiée à l’équilibre. Un des objectifs étant si possible de ralentir la maladie et de prolonger l’autonomie. La première chute pour une personne âgée est un peu traumatisante et pour un Alzheimer cela peut lui faire perdre énormément en confiance. Et lui ôter toute envie de bouger de chez lui. On a décidé de travailler sur la partie sportive en insistant sur le côté ludique du ping-pong. Avec la psychologue, on a beaucoup travaillé sur la maladie en elle-même et elle m’a expliqué comment aborder le groupe et travailler sur tous les moments où l’on n’est pas dans l’activité elle-même : L’accueil, les pauses, les interactions sociales, les sujets de discussion, et comment stimuler un peu le malade. Nous avons aussi parlé de tous les ancrages de mémorisation que ce soit lors d’exercices ou lors de situations moins précises. On répète toujours les mêmes choses de façon similaire avec les mêmes mots pour essayer de vraiment stimuler la mémoire des malades.
Pourriez-vous préciser !
Par exemple lors d’un jeu d’équilibre que l’on réalise, on touche le pied du malade toujours de manière semblable pour voir si cela permet qu’il se reconnecte. Un malade Alzheimer va avoir des phases où il est là et d’autres où il est hors circuit. Il suffit d’un petit coup de pouce et hop il revient avec nous et va se rappeler où il est… C’est rassurant pour lui car dans un premier temps il sait qu’il est en train de partir… On essaye toujours d’être bienveillants et de donner confiance… La dernière chose très importante dans ce programme au niveau de l’encadrant c’est le sourire. C’est la seule chose qui montre à l’autre qu’il est en train de bien faire. Dire oui ou non ce n’est pas la même chose en Inde, en Chine ou en France alors que le sourire quelles que soient les cultures, les générations veut dire la même chose pour tout le monde. Un malade alzheimer se demande constamment s’il va bien et le fait de sourire le tranquillise. Le cœur du projet, c’est l’activité avec en plus tous ces petits détails qui font que cela fonctionne et créé un bien-être chez les patients. Dernièrement, j’ai un patient qui venait pour la première fois. Première approche, on s’est dit que cela n’allait pas être facile et finalement il a réussi à renvoyer quelques balles. Après, il s’est reposé, a bu un coup, on a discuté et en partant il m’a dit « Merci, je suis aux anges »… C’est hyper gratifiant. Mais j’ai beau en parler à mille médecins, mille neurologues, tous me disent qu’il faut prouver l’efficacité. Or quand j’entends ce genre de propos, je me dis « Il faut foncer. «
On essaye de sensibiliser les aidants pour qu’ils nous donnent un petit coup de pouce, ce n’est pas juste entre malades. Des retraités valides jouent depuis des années au même créneau horaire et l’on essaye de les mélanger avec les malades les plus autonomes afin de jouer la carte de l’inclusion au maximum. On fait aussi en sorte que les aidants se sentent bien. Un aidant va souvent commencer à jouer un petit peu avec son aidé et très rapidement on mélange et on remercie l’aidant. Ensuite, l’aidant qui nous a aidé pour la logistique de base, va avoir quelques minutes pour jouer avec quelqu’un qui sait bien jouer, se défouler, et prendre plaisir à bouger. Certains aidants continuent à venir au club même après que l’aidé n’ait plus les capacités de venir et ait été placé en Ehpad ou dans un foyer de vie.
Comment se passe une séance ?
Les malades arrivent, s’assoient, posent leurs affaires souvent au même endroit sous l’œil des aidants. Une fois qu’ils sont là, on discute un petit peu, on analyse quelles sont les nouvelles de la semaine, on fait de petites blagues sur des thématiques qui plaisent aux malades. Par exemple, un de nos malades adore partir au ski et l’on parle souvent de ce sport par le biais d’une actualité ou autre. Un autre c’est la musique. J’ai été voir un concert l’autre jour, je lui ai raconté. On essaye de créer une petite atmosphère. L’échauffement se fait en jouant au ping-pong. Dans un premier temps on met les malades en confiance, et ils vont commencer à jouer avec quelqu’un qu’ils connaissent bien-. Cela dure entre 10 et 15mn ; puis on fait des rotations. Dans la version officielle tout le monde joue avec tout le monde, mais en réalité, cela se déroule autrement. Il y a des malades qui ne peuvent pas jouer avec d’autres malades, qui n’aiment pas certaines personnes et qui ont leurs têtes. On essaye en tout cas qu’il y ait le plus d’interactions possibles. Un aidant qui va jouer avec un malade sait quel est l’exercice qu’il doit lui faire faire mais il ne va pas lui dire. Le malade va d’abord être plongé dans un état second de concentration avec un échange régulier et petit à petit on va complexifier la situation pour accentuer la stimulation cognitive tout en gardant les encouragements. Dès que l’on voit un malade qui se repose on le laisse tranquille pendant 5 mn. S’il veut rejouer on le fait rejouer et si on voit qu’il n’est pas trop chaud rapidement on le fait participer aux jeux d’équilibre en fonction de son autonomie. L’idée c’est de les faire tous passer sans que ce soit imposé…
Aucune friction ne doit être présente, il faut que ce soit très fluide. Certains après les jeux d’équilibre sont un peu fatigués et l’on fait aussi un peu de renforcement musculaire. On veille également à ce que les malades boivent suffisamment. A la fin on, boit un jus d’orange avec quelques amandes, on discute un peu et ça se termine ainsi. Cela fait partie des situations importantes pour que le groupe des non malades puisse s’approcher d’un malade et arrivent à une discussion même celle-ci n’est pas très cohérente. Un malade alzheimer est quelqu’un qui a l’air totalement normal ce qui n’est en général pas la vision qu’a le grand public. On explique à ceux qui émettent quelques réserves pour trop se mélanger que les malades les plus autonomes vont souvent jouer avec de vrais joueurs.
En quoi consistent les jeux d’équilibre ?
Le premier exercice le plus simple même à un stade très avancé consiste simplement à être en équilibre sur un pied. Cela se fait en tournant un petit peu la tête ou en fermant les yeux. On est toujours à côté en cas de perte d’équilibre. Ensuite en équilibre sur un pied et avec la pointe de pied il faut toucher quelque chose devant et quelque chose derrière. Ce qui renforce tout l’équilibre avant arrière et certains muscles au niveau des jambes que l’on n’a pas sur une situation statique. On le fait avec eux. Quand on le fait une minute sans s’arrêter musculairement on sent que l’on a travaillé. Puis pour l’équilibre droite gauche marcher le long d’une ligne à petits pas avec une progression plus ou moins importante selon le stade de la maladie. Pour le dernier exercice eil faut en étant bien droit s’asseoir, se lever, s’asseoir, se lever, s’asseoir. On leur conseille souvent de le faire en levant un peu les mains. C’est le mouvement le plus complet pour tout ce qui est gainage et bas du corps. Une étude a été réalisée à l’Insep prouvant la corrélation entre la puissance des quadriceps et le maintien de l’équilibre de la personne. Garder des jambes un petit peu plus musclées ne peut qu’aider à se rétablir si on a une petite perte d’équilibre. Ces exercices sont réalisés toutes les semaines. Seul l’équilibre avant arrière n’est pas destiné à tous les malades.
Au niveau physique quels sont les progrès ?
Comme les personnes en bonne santé, les malades arrivent à jouer de plus en plus longtemps au fur et à mesure des séances. Une vraie progression s’effectue au niveau vasculaire et physique. Mais c’est un sport fatigant car on est debout, on piétine, ; on va de droite à gauche, on ramasse les balles avec à chaque fois une flexion supplémentaire. Sans s’en apercevoir on est tout le temps en mouvement. La proprioception de la personne évolue aussi. Par exemple, pour Laurent notre plus jeune malade, le premier confinement a été une catastrophe. Il a beaucoup perdu en terme de capacités physiques, et intellectuelles. Quand il est revenu au début, il se cognait contre la table et parfois il saignait. Mais malgré la maladie qui avait beaucoup avancé ; on s’est rendu compte qu’au bout de trois semaines, il arrivait à jouer ces balles très basses en ne se cognant plus contre la table. Il sentait mieux ce qu’il devait faire et il a conservé cette aisance. Pour la partie motricité, coordination, tout le monde progresse. On a un malade qui a une visibilité réduite, et une neurologue lui avait déconseillé de venir, sa femme aussi, mais lui voulait venir. Il est venu une fois, il a adoré mais pendant deux mois, une balle sur deux au lieu de la taper tout de suite il reculait, la laissait rebondir par terre, la tapait ensuite comme au tennis. La balle rebondissait sur la table, par terre. Il reculait, la tapait et arrivait à la renvoyer sur la table. On maintenait un échange de cette façon et petit à petit on le rapprochait un peu de la table. En deux mois, il est parvenu à jouer tout le temps à la table, comme quelqu’un qui apprend à jouer et qui fait des progrès. Il n’a plus aucun problème de coordination par rapport au ping-pong.
Le but c’est l’activité physique. Donc que la balle rebondisse quatre fois ou 10 fois peu importe du moment qu’il y a cet échange de balles.
Les bénéfices annexes auxquels vous ne vous attendiez pas ?
On n’avait pas anticipé le fait que les aidants allaient autant apprécier venir, discuter entre eux, jouer et participer à une vie de groupe. Autre chose non prévue : la partie intergénérationnelle. Ainsi pendant les vacances les petits enfants des malades peuvent venir jouer avec eux et un foyer de vie dans le 77 veut lancer l’activité. Ils se rendent compte qu’un alzheimer a de moins en moins de discussion avec ses petits enfants ou enfants et le ping-pong reste un moyen de se reconnecter et de partager un petit moment ensemble. Un malade d’Alzheimer est plutôt bien physiquement, il faut en profiter et le stimuler. C’est très plaisant de voir ce partage entre un père et sa fille. La maladie de notre plus jeune malade a avancé très vite et actuellement il a du mal. Mais dans un premier temps il jouait avec sa fille. Alors qu’à la maison il ne parle quasiment plus. La partie apathique que l’on voit dans le cadre privé disparaît complètement quand il se plonge dans cette activité. Cela lui provoque ainsi qu’à sa famille un réel bien-être. On a des malades qui aiment bien inviter de temps en temps leur frère, leur sœur à venir jouer un petit peu avec eux. Ils sont fiers de montrer qu’ils y parviennent, qu’ils font partie d’un club. Il règne une grosse émulation.
Le ping-pong un sport hypnotique
L’on s’est rendu compte que le ping-pong avait un effet hypnotique. Le fait de sentir le rythme de la balle met certains malades en état de flow, un état second englobant un état de concentration optimale. Un peu comme une auto hypnose… En cas de gros problèmes moteurs on arrive quand même à maintenir un petit peu des échanges et quand des problèmes intellectuels surviennent, la partie fonctionnelle qui renvoie la balle se réactive. Etienne par exemple qui à la maison n’arrive quasiment plus à faire d’activités et abandonne au bout de 5 minutes joue au ping-pong 1 heure et demi sans s’arrêter. On a mis en place des exercices destinés à développer cette concentration en essayant de prolonger cet état second. Etienne pour rester concentré a besoin de mouvement, d’action de rythme apporté par des échanges continus. Pour ce faire, on a une bassine pleine de balles à côté de nous et l’on envoie des balles sans arrêt. L’important au ping-pong c’est de suivre la raquette de l’adversaire pour savoir si elle va à droite, à gauche, si elle va être rapide, haute, si on va faire une feinte.
Des astuces adaptées aux différents cas
Autre exemple : Marie-Pierre qui a d’énormes problèmes de concentration. L’on a trouvé une astuce pour qu’elle reste longtemps à la table, et qu’elle joue. On lui met Carmen sur un téléphone posé sur la table de ping-pong. Elle est là, elle chante, joue pendant 1h et balance le bras comme un chef d’orchestre, sourit, regarde un peu partout. La musique la remet dans cet état de flow. Chaque malade a des besoins un peu différents. Certains ont besoin d’un repaire visuel.. Mais on ne cherche pas à mettre en avant les repères de chacun car on ne veut pas non plus stigmatiser telle ou telle personne.
Est-ce du ping-pong en simple, ou en double ?
Souvent en simple, et quelquefois en double. On ne compte jamais les points, ce n’est pas de la compétition. Le but c’est de jouer un maximum. En terme de matériel, on a beaucoup de balles, pleins de paniers remplis. Les entraîneurs, les bénévoles ramassent souvent les balles, et il n’y a pratiquement aucun temps mort, le but étant de garder beaucoup de dynamisme. Tout le matériel est fourni et les bouteilles d’eau aussi si besoin. On fait attention aux raquettes et on dit à tous les clubs qui mettent en place le programme de se servir de raquettes plutôt résistantes. La raquette peut tomber par terre, cogner un peu la table. Il faut une raquette qui n’accroche pas trop, qui n’ait pas trop d’adhérence. On respecte beaucoup le geste naturel de chacun. Les effets doivent être peu existants car la personne dotée du même niveau ne va pas pouvoir renvoyer la balle à chaque fois. On prend donc des raquettes qui ne mettent pas beaucoup d’effets. Les balles sont exactement les mêmes que pour un groupe normal afin que les non malades puissent se mélanger au maximum.
Ils vont être à peu près au même niveau et s’amuser ensemble. On va créer des situations leur permettant de progresser en groupe. Cette première phase est la plus facile à appréhender. La pathologie peut être plus axée soit sur la mémoire , soit au contraire sur la partie coordination, motricité et l’on utilise des exercices ou des situations spécifiques. Pour certains c’est difficile de renvoyer la balle à chaque fois au-dessus du filet. A ce moment là, on l’enlève en gardant les échanges et le même concept. Les malades très avancés et plus âgés vont jouer sans filet et assis. Les plus jeunes même avancés peuvent se tenir un peu debout devant la table. On va les mettre en confiance avec une situation très simple, la balle va juste rouler et on va changer un petit peu les trajectoires. Il ne faut jamais que ce soit présenté comme une contrainte et les malades doivent agir en fonction de leur humeur du jour. On a un créneau en début d’après-midi et un le matin. En période normale, 16 malades ont 30 tables à leur disposition dans une salle de 900 m2. Le plus âgé a 87 ans, mais il n’est pas très avancé dans la maladie.
Qu’est-ce qui est le plus difficile côté enseignement ?
De voir que la maladie avance quand même. Mais tout montre que s’ils étaient moins actifs ils auraient avancé plus vite dans la maladie. Mais c’est difficile de faire une évaluation car l’on ne connaît que la réalité actuelle. On s’occupe du même patient depuis plus de trois ans et chaque famille stimule différemment son malade. On en a deux ou trois qui en trois ans sont très stables mais qui après les vacances d’été prennent un petit coup quand même. Ils ont perdu soit en motricité soit en tenue de corps. On ne sait pas si c’est le manque de ping-pong ou le fait de ne pas être stimulé comme habituellement au quotidien. Lors du premier confinement, tous ont perdu un peu en autonomie. Ou en tout cas ont avancé dans la maladie. Le plus gros problème pour nous ce n’est pas la mémoire, c’est la concentration. Avoir un malade qui va se mettre à déambuler, que l’on a du mal à garder avec nous. C’est pour cette raison qu’une des priorités au début c’était de savoir comment les garder à la table. Et puis l’on s’est rendu compte que chacun avait un besoin différent. Au début, on n’avait pas trop les solutions, maintenant on les laisse déambuler un petit peu. Après si on sent qu’ils n’ont pas trop envie de jouer on les fait s’asseoir et l’on discute. Si certains ont besoin de marcher dans la salle pas de problème, la salle est grande. La déambulation c’est simplement parce qu’ils ont décroché. Des déclencheurs nous permettent de les remettre en route. Notamment la phrase « Renvoies la balle « que l’on utilise tout le temps. En tout cas cela fait plaisir, car ils rigolent, racontent des blagues.
Des malades métamorphosés
Les aidants nous disent qu’ils ne sont jamais comme çà chez eux. Apparemment c’est le jour et la nuit, mais je ne les vois que pendant le jour. Ils parlent de cette activité chez eux et one envie de revenir. Les bénévoles de France Alzheimer nous ont dit qu’il y en a certains qu’ils ne reconnaissent plus. Même si parfois ils ne se souviennent pas d’une personne, ils n’oublient jamais qu’il vont au ping-pong. Des réactions surprenantes ? Une ou deux fois, un malade au lieu de nous renvoyer la balle nous a lancé sa raquette mais c’était avec douceur donc sans incidence...
Je pense aussi que certains professionnels voient des différences mais ils ne vont pas s’avancer sur ce terrain là, sans études. Ils veulent des preuves scientifiques.. Dans quelques clubs, l’on peut jouer toute l’année et l’idée c’est de le mettre en place dans ce genre de club Même encore plus régulièrement comme un foyer de vie. La fédération allemande est intéressée. Il y a peu, j’ai fini de former des professeurs à Toronto au Canada. Quatre Ehpad veulent lancer le programme en association avec des clubs locaux. Ils vont faire exactement la même chose que nous et veulent aussi utiliser le ping-pong comme un média de reconnaissance avec la famille. C’est un réel questionnement pour des résidences de personnes âgées.
Avez-vous eu l’occasion de discuter avec des professeurs utilisant d’’autres sports avec les malades Alzheimer ?
Un peu avec des professeurs de basket, activité lancée dans l’est de la France. Mais au final ils ont arrêté car le ballon peut faire mal et ils ne peuvent pas le donner à n’importe qui. Aussi avec quelqu’un qui a lancé un tai-chi-chuan très doux. C’est pareil il existe un moment où à un certain stade de la maladie on ne peut plus expliquer les mouvements. Même si on montre le malade ne réagit plus. Une partie du cerveau du malade n’est plus là. 15 clubs en France ont maintenant lancé l’activité ping-pong. On essaye de recréer des connections entre les antennes France Alzheimer et les clubs de ping-pong où il règne un peu de dynamisme. Beaucoup de clubs sont intéressés car ils s’aperçoivent vite des bénéfices et d’ici 2022, on, espère que 40 à 50 clubs auront adopté le projet.
Agnès Figueras-Lenattier
16:19 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : association, ping-pong, alzheimer
mercredi, 13 octobre 2021
Christine Janin
 Quatre ans après l’édition de son premier livre, Christine Janin alpiniste (première française au sommet de l’Everest) et médecin a réitéré il y a quelques mois avec un deuxième « Dame de pics et femme de cœur ». Toujours aussi passionnée, authentique, elle a pris un peu de son temps pour parler de son association « A Chacun son Everest » qui aide les enfants et les femmes atteints de cancer.
Quatre ans après l’édition de son premier livre, Christine Janin alpiniste (première française au sommet de l’Everest) et médecin a réitéré il y a quelques mois avec un deuxième « Dame de pics et femme de cœur ». Toujours aussi passionnée, authentique, elle a pris un peu de son temps pour parler de son association « A Chacun son Everest » qui aide les enfants et les femmes atteints de cancer.
Après toutes ces années à la direction de l’association « A chacun son Everest» quel bilan tirez-vous de votre action?
Cela fait maintenant 26 ans que j’ai débuté et j’ai accompagné 6000 personnes dont 4700 enfants et 1400 femmes. J’aime à dire maintenant que j’ai quelque peu inventé la médecine de l’Everest, la médecine de l’âme. Et le cancer je l’écris « quand sert », une maladie qui va permettre aux femmes et aux enfants de s’en servir pour acquérir une force et une arme puissante dans la vie…. Depuis toutes ces années, je trouve que ces enfants qui viennent en stage possèdent une force incroyable et une motivation à toute épreuve. Quant aux femmes, j’ai démarré il y a exactement 10 ans. Celles-ci profitent notamment du fait que cela se passe en groupe pour se sentir épaulées : « Je ne suis pas seule, les autres ont vécu la même chose, je peux partager de bons moments. On prend en considération toutes mes peurs, ma fatigue ». Il règne une compréhension mutuelle qui les aide à reprendre le dessus.
Vous dites que parmi les femmes atteintes d’un cancer du sein beaucoup sont portées vers les autres !
Toutes ces femmes devraient prendre beaucoup plus soin d’elles car elles s’occupent avant tout de leur mari, des enfants, de tout le monde sans se soucier de leur propre santé. Elles devraient s’accorder du temps pour encore mieux prendre soin des autres. Or elles ne s’autorisent pas grand-chose toutes ces petites dames…
.Croyez-vous au rôle du psychosomatique dans la survenue d’un cancer ?
Dans une certaine mesure mais il faut faire attention et ne pas dire « c’est à cause de ». Cela mettrait la personne en difficulté et la culpabiliserait. Mais il existe un moment où les événements n’arrivent pas par hasard et souvent la maladie survient en cas de fragilité. Il faut alors en profiter pour se questionner : Qu’est-ce que je fais de ce message, comment puis-je le transformer ? Que dois-je dois changer dans ma vie pour aller le mieux possible ?
Qu’est-ce qui est le plus dur pour ces femmes lors de ce séjour ?
Rien de vraiment difficile car tout est fait pour les accompagner dans la bienveillance, l’écoute, et en se mettant à leur niveau. En arrivant, certaines femmes ont un peu peur du groupe alors que d’autres se réjouissent de ce moment de partage. Chaque femme vit le séjour complètement différemment. Tout est calculé au niveau environnement et l’on essaye que ce soit joli. On a un très bel espace, une très belle maison, un bel accueil, et dans les chambres on a mis de jolis rideaux. De petites attentions leurs sont destinées et lorsqu’elles sont sur place, elles découvrent de belles petites fleurs. Il faut qu’elles se sentent bien dès leur arrivée et qu’elles aient le sentiment qu’on les attend, qu’on prend soin d’elle et surtout qu’on les accueille. D’ailleurs, ce séjour engendre souvent la survenue d’un déclic qui leur redonne de l’énergie. L’on essaye qu’elles retrouvent la pêche et qu’elles repartent avec moins de peur et plein de projets.
Comment se déroule une semaine pour ces femmes au sein de votre association ?
Tous les jours, a lieu une activité en lien avec le bien-être. Elles font du yoga, de la méditation, du Qi Qong, ont droit à une séance avec une psychologue, et à un massage. Marche, escalade. Tout ce qui peut aider à se centrer, à respirer. Se déroule aussi un atelier photo pour retravailler sur l’image de soi, la confiance. Il est très important que ces femmes remettent leur corps en mouvement car le sport aide à guérir. Il permet de retrouver de la joie, et une énergie perdue. Il m’arrive de les emmener aux Thermes de Saint-Gervais. C’est le retour au maillot, à l’eau, pour être ensemble et partager ce moment. Je les fais danser aussi le vendredi soir car elles ont besoin de lâcher prise, de sourire à la vie et de retrouver une âme d’enfant.
Et avec les enfants ?
Je les emmène à Chamonix, gravir des sommets, grimper, faire de l’escalade. On leur permet de quitter leurs parents, de faire du sport, de partager de bons moments ensemble, et surtout de se prouver que ce sont des enfants comme les autres, même mieux. Qu’ils ne sont pas que des enfants malades, que ce sont de petits champions. Ils suivent aussi de courtes séances de yoga, de méditation, de sophrologie et après le repas se déroule une petite relaxation. . Sans oublier la boum tous les vendredis soir.
Dans quel état d’esprit sont les enfants lorsqu’ils rentrent chez eux ?
Ils ont vécu la plus belle semaine de leur vie, et se sont prouvés plein de choses. Certains reviennent 20 ans après et nous disent à quel point cette semaine a été importante pour eux. Ils ont réalisé des choses qu’ils n’auraient jamais faites autrement. Des parents nous expliquent qu’il existe un avant et un après à « Chacun son Everest » car l’enfant a repris confiance en lui.
Dans ce livre vous rendez compte des changements que vous avez effectués !
La vie est un perpétuel changement et l’on essaye constamment d’améliorer les conditions de vie. Par exemple, on a créé un jardin botanique qui nous permet d’avoir nos propres tisanes.. On a aussi insonorisé la salle d’escalade. Dès que l’on peut apporter un plus à ces enfants et ces femmes, on le fait.
Et la nourriture ?
C’est essentiel aussi et l’on y fait très attention. On prépare des plats sans sucre, avec peu de graisse. On ne mange pas beaucoup de viande et beaucoup de légumes. Il faut que ce soit joli, esthétique, et la nourriture fait aussi partie du traitement…
Durant le confinement vous vous êtes occupée des soignants!
Oui, j’avais stoppé un peu les activités habituelles de l’association et ayant donc ce lieu à disposition on a réussi à proposer aux hôpitaux locaux de recevoir quelques soignants. Quel que soit le métier, infirmiers, médecins, sages-femmes, lingères tous étaient dans un état de stress incroyable et d’épuisement complet. . Certains arrivaient parfois en larmes, d’autres étaient presque en burn out. C’est la première fois que l’on prend soin de nous » m’ont-ils déclaré. Ce séjour leur a permis de repartir et on leur a donné des outils pour prendre soin deux. C’est bien de soigner les autres mais si on ne prend pas soin de soi, on replonge. En 2,3 jours on les a remis d’aplomb. Ils ont pu continuer leur travail alors que la tentation d’abandonner était parfois de mise.
De quelle manière ?
J’ai fait exactement comme pour les femmes. Après les avoir accueillis, on leur a fait des soins de support, on les a fait marcher, rire, on les a écoutés, et on a eu recours à la psychologie, à la sophrologie. C’était très intense. Ils se sont posés et se sont sentis reconnus. On les a bichonnés et pendant trois jours, ils n’ont rien eu d’autre à faire que de se laisser porter. Cela leur a fait beaucoup de bien comme à tout le monde mais encore plus à eux tellement ils étaient au bout du rouleau. Les conditions hospitalières sont peu favorables. Ils manquent de personnel, ne sont pas payés et il reste encore beaucoup de choses à faire les concernant. Ceci au sein de tous les services. Il règne une maltraitance évidente pour les soignants et ils sont baladés de jour et de nuit. Beaucoup de moyens ont été mis en place sauf pour les soignants ce qui n’est pas très normal. Je suis très en colère…
Vous citez le livre de Marie de Hennezel « La mort intime » comme un ouvrage vous ayant aidée dans votre métier !
Oui car malheureusement je suis confrontée au sein de mon association mais pas seulement
à des gens qui vont subir des moments difficiles de fin de vie. Ce livre m’a appris comment leur parler, comment les accompagner. On est dans une société où l’on a peur de la mort, où les gens ne savent pas en parler et j’avoue que ce livre m’a éclairée. A quel point c’est important de ne pas avoir peur de la mort, de la maladie. C’est vraiment ce message là que j’en ai retiré. Le mot cancer fait peur et j’ai appris avec cette lecture à m’occuper de ces gens en difficulté avant de toujours évoquer la fin de vie. Ne pas leur tourner le dos et les seconder dans ces périodes essentielles de la vie… C’est un ouvrage que je conseille…
Agnès Figueras-Lenattier
02:46 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 11 octobre 2021
Taha Mansour


Au Théo théâtre et à La Comédie Saint-Michel se jouent en ce moment deux spectacles interessants : « La mystérieuse histoire de Thomas Polgarast" (Théo Théâtre jusqu'au 15 décembre et reprise en 2022), un spectacle de mentalisme où les personnages de la pièce sont choisis parmi le public. Taha Mansour l’auteur en avait conçu un autre avant, intitulé « L’effet papillon « classé meilleur spectacle de magie, mentalisme qui se joue également en ce moment à La Comédie Saint-Michel jusqu'au 2 février . Taha Mansour a plusieurs cordes à son arc. Ingénieur de formation, mentaliste, il suit des managers en entreprise et donne des cours de gestion en entretien d’embauche dans différentes écoles. Il adapte aussi les techniques de mentalisme et d’hypnose en préparant à la prise de parole en public. Il s’est également formé à la musique en chant particulièrement. Il explique ici quelque peu son parcours…
Vous êtes mentaliste. Qu’est-ce qu’un mentaliste et quelle formation faut-il suivre?
Il existe plusieurs définitions. Pour moi, c’est un mélange de différentes techniques psychologiques destinées à lire dans la pensée des gens, influencer, prédire des événements. On peut dire que finalement c’est la magie de l’esprit. Côté formation, je suis un peu autodidacte. Lycéen, j’ai commencé à beaucoup m’intéresser à la psychologie, au comportement humain, et à essayer de comprendre le langage non verbal des gens. Puis j’ai étudié longtemps l’hypnose, les techniques de PNL, tout ce qui tourne autour de la cognition et j’ai ensuite mis en pratique le côté théorique. J’ai mis plus d’un an à obtenir des résultats. Au début, je n’y parvenais pas du tout. Ayant fait un peu de magie, ça m’avait aidé pour rencontrer des gens, mais les pensées que je leur attribuais étaient inexactes. Je leur disais alors qu’on allait faire autre chose. Je testais plusieurs choses, puis avec le temps, j’ai tiré des leçons de mes erreurs et ça a fini par fonctionner…
Quelle sorte d’hypnose avez-vous apprise ?
J’ai d’abord suivi des conférences se rapportant à l’hypnose dédié au spectacle, et ensuite j’ai étudié toutes formes notamment l’hypnose thérapeutique, j’ai lu des livres, et au fur des années, je me suis entraîné et ai expérimenté sur différents modèles psychologiques. Et je suis en train de passer une certification d’hypnose thérapeutique.
Avez-vous été vous-même hypnotisé ?
Oui, et je suis très réceptif !...
Un mentaliste est par définition un manipulateur!
Oui en quelque sorte, mais un manipulateur gentil. Quelque chose me tient particulièrement à cœur, c’est le côté honnête ou pas. Ainsi, je fais beaucoup d’influence et il existe une différence avec la manipulation. Quelqu’un qui influence, c’est quelqu’un qui va être loyal avec la personne en face. Les spectateurs qui viennent voir un spectacle de mentalisme savent qu’ils vont être manipulés. C’est un peu le contrat établi au départ. Alors que les manipulateurs dans la vraie vie vont essayer de modifier la pensée des gens et autres à des fins personnelles. Cela fait naître beaucoup de mensonges, de déceptions, de trucages.
Vous avez également une formation dans la musique! Et en comédie ?
Oui et mon expérience musicale m’a beaucoup aidé quand j’ai débuté dans la comédie. En effet, de nombreux concepts se traduisaient d’un monde à l’autre et je me suis beaucoup amusé à trouver des liens entre le chant et la comédie. J’ai eu plusieurs professeurs de musique au lycée qui m’ont accompagné et stimulé ; j’ai fait partie d’une chorale. Je chante depuis que je suis tout petit et j’interviens dans des scènes ouvertes, lors de concerts. Surtout de la musique pop rock. J’ai fait pendant longtemps de l’improvisation théâtrale et j’en fais toujours, ce qui me donne de la présence sur scène. C’est la première fois pour « La mystérieuse histoire de Thomas Polgarast que je compose. J’ai écrit la musique et les paroles de la chanson que j’interprète…
Avant d’écrire « La mystérieuse histoire de Thomas Polgarast, vous avez conçu un autre spectacle « L’effet papillon qui a obtenu un vrai succès !
C’est mon premier spectacle et également ma première expérience en tant que comédien. J’ai mis à peu près trois ans à l’écrire car en parallèle je faisais une prépa et disposais de peu de temps. La première fois que je l’ai joué c’était en 2017 dans le théâtre de mon école d’ingénieur et l’année d’après, je l’ai proposé au sein de salles parisiennes. Je suis franchement content et je ne m’attendais pas à un tel retour. Il a 10 sur 10 sur Billet Réduc et a été éligible en 2020 aux Petits Molières. Mais avec le Covid, la saison a été annulée. La cérémonie devrait avoir lieu cette année et je verrai si le prix a été remporté ou pas…
Comment avez-vous conçu ce spectacle ?
Lorsque j’ai commencé à être de plus en plus à l’aise avec le mentalisme, j’ai découvert le phénomène de l’effet papillon qui m’a fasciné : de petites choses se passent autour de nous qui ont un grand impact. Ce qui m’avait marqué c’est que ce thème revenait souvent dans les films ou dans l’art mais qu’il était surtout axé sur l’événement final, la tornade et non pas sur l’événement initial le petit papillon. J’ai alors pensé « Et si dans notre vie de tous les jours on était de petits papillons qui battaient nos ailes et que l’on ne se rendait pas compte de l’immense impact que l’on avait sur le monde. A partir de ce phénomène là, j’ai créé le numéro central du spectacle, un numéro où je prends différentes personnes avec différents choix en créant un peu le chaos. Mais au final, tout ceci nous mène à une seule sortie, celle qui avait été prédite à l’avance… Le but du spectacle était de partager des messages et des sens poétiques qui me touchaient beaucoup. Dans notre société d’aujourd’hui, on est tellement focalisé sur nos tâches, nos tâches que l’on ne prend pas le temps d’avoir du recul sur la vie et l’on passe à côté d’énormément de petis mystères se déroulant dans notre quotidien. C’est un peu le message final du spectacle, ces petites choses que certains appellent des ondes, d’autres des énergies , ou encore des coïncidences. Quoi qu’il en soit, cela me provoque un sentiment d’émerveillement et le plus important pour moi ce n’est pas la raison pour laquelle ça existe mais le fait que cela nous fasse vivre et agir…
Dans « L’histoire mystèrieuse de Thomas Polgarast, contrairement à « L ’effet papillon », vous jouez un personnage et la séance d’hypnose est plus travaillée. Quant à la musique, elle est belle et accentue bien l’atmosphère que vous avez voulu dégager !
Oui. Mon ami Antoine Piolé que j’ai rencontré en 1ère année d’école d’ingénieur est un passionné de musique et très compétent. Lorsqu’il m’a montré ce qu’il faisait, j’ai tout de suite compris que son style conviendrait parfaitement à mes spectacles. Il a aussi travaillé sur « L’ effet papillon ». Je lui ai expliqué l’histoire que je voulais raconter, les sentiments qui prendraient forme. Il m’a proposé quelque chose, nous l’avons peaufiné ensemble et nous nous entendons super bien…
Dans ce spectacle au Théo Théâtre, vous invitez des spectateurs à venir sur scène et vous raisonnez en fonction de leur attitude, de leurs gestes. Dans la vraie vie vous fiez-vous ainsi au comportement silencieux d’une personne pour vous faire une première idée sur sa personnalité ?
Absolument. C’est quelque chose que j’utilise beaucoup. Pas une intuition psychique, mais l’intuition d’un expert qui en cas de problème se fie à son savoir. Une espèce de petite voix le guide et lui indique ce qu’il faudrait faire. Effectivement, quand je vois quelqu’un, des pensées le concernant me viennent à l’esprit. Celles-ci sont quelquefois erronées, mais dans la majorité des cas, j’arrive déjà à avoir un excellent point de départ qui en approfondissant ma vision de cette personne va me permettre de l’influencer et de l’emmener où je souhaite…
Agnès Figueras-Lenattier
12:44 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, mentalisme, interview
lundi, 16 août 2021
Emmanuel Stip

Emmanuel Stip est professeur de psychiatrie et chef du département universitaire à l’université des Emirats Arabes Unis depuis l’étét 2019. Ses intérêts sont la neuropsychologie, la cognition, la phénoménologie, l’imagerie cérébrale, la psychopharmacologie, la santé mentale globale et l’histoire de la psychiatrie. Il est l’auteur de livres de nouvelles, photographe et son dernier livre chez l’Harmattan s’intitule « Vin et psychiatrie ».
Votre dernier livre s’intitule « Vin et psychiatrie ». Le titre paraît étonnant au premier abord !
Au départ, le sujet peut effectivement paraître saugrenu mais le vin a quand même une histoire. Lorsque j’ai terminé mon mandat en tant que chef de département universitaire à Montréal, j’ai eu droit à une année sabbatique avec l’aide financière d’une grande université. Je pouvais faire ce que je voulais et j’en ai profité pour faire le tour du monde en 4 mois. Je venais de créer une nouvelle dénomination pour le département psychiatrique de l’Université de Montréal et d'addictologie et j ’ai été voir ma doyenne qui m’a demandé ce que j’allais faire comme études.. Je lui ai répondu que j’allais faire une formation en addictologie. Elle a souri mais jamais elle ne m’a dit « c’est catastrophique ». Au cours de cette formation, je me suis aperçu que j’agis de la même manière en sémiologie et en psychiatrie. Je détecte, je cherche des signes, je trouve et à la fin j’aboutis à un diagnostic. Il existe également des classifications dans les deux cultures. Côté psychiatrie, cela va déterminer un traitement, une attitude, un congé et côté sommellerie cela indiquera le prix du vin, son nom, son étiquette. Par la suite, comme j’étais chercheur en imagerie cérébrale et cognition, j’ai découvert toutes les études que l’on a faites sur l’olfaction, le goût, l’activation cérébrale chez les sommeliers que l’on comparait à des populations normales.
Surprise des médecins
Au départ, les médecins étaient surpris par mon livre car ils ne voyaient pas les rapprochements entre les deux domaines. Mais maintenant quand ils lisent mon travail ils comprennent les addictologues ont même rédigé un chapitre. Ce n’est pas du tout un livre caché, bien au contraire. iI est promu par mes collègues médecins comme étant une source de dialogue même avec les patients ou la population. Le préfacier Emmanuel Haffen le dit, au départ cela semble bizarre mais on avait déjà été sollicité lors de congrès de médecine à communiquer sur le vin et la psychiatrie. Au même titre qu’actuellement, on communique beaucoup sur le cannabis, le LSD et la psychiatrie. Je ne voulais pas que mon livre soit lu uniquement par des médecins mais aussi par des sommeliers même s’il abordait les aspects de la médecine. Inversement, je souhaitais que les médecins trouvent amusant de parler de la culture du vin. C’est un mixte.
Dans votre livre, l’on s’aperçoit que depuis l’Antiquité jusqu’à la renaissance le vin était utilisé comme une substance thérapeutique !
Oui, comme d’autres éléments de la pharmacopée, il a été utilisé soit sous forme de pansements, de soupes, de cocktails. Puis à un moment donné, l’on pouvait même donner du vin aux patients. On s’en est servi au sein des hôpitaux et l’on en a aussi cultivé. Cela faisait partie de ce qu’un français boit tous les jours. Avec malgré tout un certain nombre de précautions. On a vu se développer chez les moines toute la culture du vin, qui en même temps se propageait au sein des organismes religieux développant les hospices, les hôpitaux, les asiles. Cela s’est fait en parallèle sans trop de questionnements au départ.
Rabelais recommandait le vin !
Oui. Médecin, moine, pédagogue, il proposait de nouvelles techniques pédagogiques. IL était habité par une joie de vivre et les personnages qu’il a créés incarnaient un certain épicurisme. Il règne un quelconque désordre dans la manière dont il suggérait que l’on boive.
Après il y a eu Pasteur et d’autres médecins partisans du vin aussi !
Oui, même dans des revues comme "The Lancet ", on considérait le vin comme un médicament. Puis est venu le développement de l’hygiénisme impliquant une surveillance plus importante et justifiée car on s’est aperçu des dégâts de l’alcool. Dans certains coins de France c’était le calva, le cidre qui faisaient des ravages avec une tentative de différencier l’alcool fort du vin ce qui a donné plusieurs courants. On a commencé à avoir un discours beaucoup plus prudent par rapport à la consommation de vin. Se sont mises en place des guerres d’ailleurs encore présentes, des batailles de lobbying entre une médecine un peu prohibitionniste et les développeurs de la culture qui disaient « Ce n’est pas si nuisible que cela pour la santé si l’on boit modérément ». Du reste, je n’aurais pas pu publier ce livre n’importe où et dans n’importe quelle collection médicale.
Comment s’est opérée cette méfiance vis-à-vis de l’alcool ?
Une amélioration de la médecine clinique s’est fait sentir quant aux maladies générées par l’alcool. Que ce soit les démences, les maladies du foie, ,les cancers. Ceci depuis au moins 1 siècle et le discours médical a totalement changé. Avec le cannabis c’est la même chose. J’écris que la coke faisait partie du vin Mariani par exemple. Ainsi en mettait- t-on dans le vin et des millions de bouteilles se sont vendues en Europe. Certaines substances reconnues comme des médicaments à une certaine époque deviennent ensuite des drogues illicites. Le vin n’était malgré tout pas reconnu comme complètement illicite même si la prohibition a eu lieu aux Etats-Unis. Il a fallu du temps pour que l’on prenne conscience de l’importance des dégâts chez les jeunes au niveau des maladies hépatiques, de la démence. Actuellement il règne un certain équilibre dans le discours, et le but du livre c’était de montrer que deux cultures maintenant très antagonistes se sont côtoyées pendant longtemps. Il existait plein d’interactions. Je me suis aperçu avec les patients que je traitais davantage sur le plan addictologie que psychiatrie que mon discours était plus proche d’eux que celui d’un addictologue qui leur disait juste « Arrêtez de boire » . On pouvait partager une culture et dialoguer sur le sujet. On se rendait compte que l’alcool pouvait être très nocif pour des personnes grandement vulnérables. Je vis maintenant à Dubaï et je réalise que plutôt que de se contenter d’interdire, il existe une manière d’en parler qui permet aux deux cultures de communiquer..
Vous personnellement que pensez-vous du rôle du vin ?
Je vous réponds comme un funambule, et en tant que médecin, ce qui me préoccupe c’est la santé de mes patients. Je me suis beaucoup intéressé aux patients psychotiques et aux effets des drogues sur la psychose et suis très alerté par les dangers de l’alcool. Je pense que la culture du vin fait aussi partie de la culture des civilisations chrétiennes. Je le dis dans le livre, dès que le vin est contenu dans une bouteille, il devient un élément naturel et en même temps culturel. Et ce serait très dommageable pour une culture de supprimer tous ces éléments là qui créent des liens sociaux, des espaces comme les bistrots, les restaurants. Et qui catalysent des réunions d’amis quand on a des convives chez soi. Cela n’est pas forcément synonyme d’ivresse. On peut apprécier tout ce qui se passe dans un verre sans pour cela être complètement malade. C’est un équilibre à trouver entre le vin et la prévention et les soins que l’on doit donner aux gens qui ne sont pas capables de s’arrêter. Qui consomment trop, ou qui font un mauvais usage de l’alcool.
Le vin en Australie
En Australie, ce sont les médecins qui ont implanté la culture du vin. C’est fabuleux, et l’on trouve là-bas, des vignobles extraordinaires avec des vins de très grande qualité. Il y a même un médecin australien qui ajoutait du resveratrol un anti oxydant dont on dit qu’il est un bienfait pour le vin dans ce qu’on appelle « le french paradoxe ». Donc, les médecins se sont intéressés à ce sujet sans pour autant favoriser l’alcoolisme. Par contre, je sais qu’en France c’est interdit de faire la promotion du vin en tant que médecin. Je comprends toute cette prudence et le livre n’est pas fait pour encourager les gens à « picoler ». Je pense qu’il est fait pour que l’on découvre un monde fabuleux où règne un respect pour le vin qui procure de grandes joies et dont les étapes sont très respectables. Je ne suis pas un prohibitionniste, je dis qu’il faut faire attention.
La couleur que ce soit celle d’un vin ou d’un médicament fait naître un effet placebo !
Ce qui m’intéressait en tant que scientifique de la cognition et de l’imagerie cérébrale, c’était de savoir ce qui influence notre appréciation lors d’une dégustation d’un verre de vin. Cela peut venir de la couleur, mais aussi du prix. Aussi d’ un renseignement sur l’étiquette ou sur la provenance. Lorsque l’on fait des dégustations en double aveugle, on s’aperçoit qu’il existe des influences très subjectives et inconscientes. Si l'on vous dit qu’un verre de vin coûte 90 dollars et un autre 10 inconsciemment vous allez trouver le verre le plus cher meilleur. Pour un médicament, le prix aura sûrement aussi une influence sur le patient. De nombreuses thèses sur le sujet ont été écrites. Et en médecine lorsque je faisais de la recherche, pour vraiment se comporter en médecin, l’on utilisait des substances contrôle et l’on avait besoin d’être en double aveugle pour bien apprécier l’effet d’un médicament.
Vous parlez d’un même vin lors d’un concours apprécié de la même manière simplement par 10% des sommeliers !
Oui, il existe une différence d’appréciation, c’est la raison pour laquelle on utilise des grilles d’évaluation où l’on détaille élément par élément afin d’ avoir une certaine objectivité. Malgré cela, ça n’empêche pas que certains trouvent un vin bon et d’autres non. Après, il faut que cela corresponde au barème de qualité que l’on a à l’intérieur de nous. C’’est la même chose avec les effets secondaires. J’avais fait une étude il y a une vingtaine d’années sur le lithium un régulateur de l’humeur que l’on donne aux bi-polaires et aux maniaco-dépressifs. Beaucoup se plaignaient de troubles de la mémoire, de concentration. Or à un moment donné, j’avais proposé un projet de recherches sur des sujets sains, des volontaires ayant accepté de prendre ce produit pendant trois semaines, et je l’ai comparé au placebo. Je leur avais donné toutes les informations sur les effets comme la diarrhée, tremblements. On ne savait pas s’ils prenaient ce traitement ou pas, mais j’avais fait pendant un mois des évaluations de la mémoire, de l’attention, des fonctions exécutives. Je voyais les patients toutes les semaines. On faisait le test et en même temps je recueillais les effets secondaires. L’effet placebo a bien fonctionné car je n’en avais pas dans mon groupe lithium mais dans le groupe placebo avec des sujets normaux.
Un classement des vins et des maladies a été effectué. Ont-ils coïncidé ?
Oui, les grandes classifications se sont faites à peu près au même moment. La classification des vins a été réalisée aussi dans un but mercantile avec une recherche de qualité pour bien le commercialiser. En médecine c’est un peu la même chose, on s’est mis à classifier pour obtenir de bons diagnostics, de bons traitements car les patients n’étaient pas tous semblables. Après, on a pu développer des médicaments pour des maladies plus spécifiques. C’est un peu la même démarche. On est en face d’une population, d’une collection de vins ou de médicaments et l’on commence à classifier selon des caractéristiques. Quand je fais un diagnostic en psychiatrie, il existe aussi une subjectivité. Même si je suis un bon clinicien, la relation inter personnelle, la façon dont je vois le patient, mon humeur du moment peuvent teinter mon diagnostic. Je peux trouver le patient plus triste, plus joyeux selon l’état dans lequel je suis. Ou selon la façon dont il parle et cette subjectivité est la même concernant la classification du vin. C’est aussi un parallèle intéressant qu’on ne pourrait pas trouver avec d’autres disciplines de la médecine. Je n’aurais pas pu écrire ce livre il y a 20 ans car on n’avait pas fait d’études par exemple sur les sommeliers, sur la subjectivité, la mémoire dans le vin etc… L’originalité du livre c’est d’avoir bien développé ce côté là. Une nouvelle science a vu le jour, la neurooenologie qui étudie tout le processus du système nerveux central du cerveau pour créer un vin et le déguster.
On peut aussi voir maintenant ce qui se passe dans la tête du sommelier ou de celui qui déguste ou du malade psychique
J’ai d’abord fait de l’imagerie cérébrale fonctionnelle avec des patients déprimés ou psychotiques.. L'on regarde comment le cerveau s’active et fonctionne. On fait la même chose avec les sommeliers et les gens quand ils dégustent du vin. On s’aperçoit que selon le savoir et l’expérience du sommelier, l’information ne va pas être traitée de la même façon alors que c’est une dégustation. C’est juste un liquide qui entre dans la bouche que l’on avale ou que l’on crache mais cette action nous permettait aussi de voir quels étaient les réseaux neuronaux impliqués dans la dégustation, le plaisir etc.. Ce sont des études relativement récentes mais assez passionnantes car l’on apprend des choses non seulement sur les sommeliers mais aussi sur le cerveau humain, l’olfaction, le goût etc.
Vous déclarez que le vin est le seul qui entretient un rapport singulier avec la parole et que tantôt il la menace, tantôt il la libère… En psychiatrie c’est un peu la même chose avec la parole !
Oui c’est très important et c’est une originalité de la psychiatrie. On base notre thérapeutique sur une relation humaine mais qui se fait avec quelqu’un qui parle, qui raconte sa vie, ses souvenirs, ses peines ou ses joies, sa douleur. La psychothérapie nécessite donc une étape où le patient va pouvoir se sentir bien pour parler même si parfois les paroles sortent sans qu’il en ait trop conscience. A ce moment là, le psychiatre est là aussi pour interpréter, pour expliquer et entretenir une relation basée sur cette confession. Quant au vin dans n’importe quel groupe social dans nos sociétés occidentales, il a aussi cette fonction. Il libère un petit peu. Quand on organise un cocktail, un vernissage, un restaurant, on va trouver le vin bon, accordé à un mets, à tel ou tel formage. Parfois, l’alcool est un peu désinhibiteur, mais par contre l’excès aboutit à des souffrances. C’est un peu l’effet délétère du vin quand on en consomme trop ou mal.
Vous dites qu’aussi bien le sommelier que le psy aime les rencontres individuelles !
Il n’existe pas un sommelier qui soit seul chez lui. Un sommelier par définition a un rôle social, il va vous décrire, dialoguer, vous demander ce que vous aimez, va essayer de percevoir chez vous et chez la personne assise à la table ce qu’est sa personnalité, pourquoi pas ses moyens financiers, son origine. S’il préfère le blanc ou le rouge. Ceci pour trouver le vin qui lui convient. Le psy c’est pareil. Il va essayer de détecter chez son patient ses origines, sa direction, son orientation etc.. Le sommelier n’a pas n’importe quel produit pour entrer en relation. C’est un produit vivant, varié, culturel qui est en même temps un produit de la nature. C’est souvent une belle nature, un produit qui a tenu compte du soleil, de la pente d’un côteau, d’une rivière, du nombre de cailloux dans la terre, de l’art avec lequel on l’a cueilli. C’est tout cela. Il existe beaucoup de respect dans cette relation, un peu comme en psy. Un psychiatre respecte son patient, et même si celui-ci dit des bêtises, il va essayer de comprendre. On retrouve de nombreuses similitudes.
Le cadre aussi est important dans les deux !
Souvent en psy, on néglige de plus en plus les lieux. Or pour qu’une rencontre se fasse souvent de façon confidentielle et de qualité, et que la personne se sente à l’aise pour parler ; le bureau d’un psy a son importance. Un. sommelier c’est pareil. Quand les sommeliers passent leur diplôme et qu’ils deviennent master of wine, il faut une ambiance particulière. Pas de parfum autour d’eux, et avec un contexte qui fait que la dégustation va impliquer le maximum de qualité. Si le contexte est approprié, la dégustation n’en sera que plus bénéfique. En revanche, si l’on se trouve dans un restaurant ou un bar bondé, la dégustation sera différente, plus festive. Il faut s’adapter.
Vous parlez des progrès fantastiques qu’a faits la médecine mais au détriment du temps accordé aux patients.
Maintenant, les gens entrent dans le bureau d’un docteur, dans un hôpital et trouvent les médecins en face de leur ordinateur regardant davantage les examens que la personne elle-même. Ils regardent les examens complémentaires, la prise de sang, se demandent s’il faut faire une radio. Tout le dialogue avec la personne est comme négligé au profit de la technique, du laboratoire etc… En psychiatrie c’est très dommage car on a besoin d’entrer en relation avec la personne qui doit sentir qu’on l’écoute, que l’on ne se base pas uniquement sur les examens. . En sommellerie, la même chose peut se produire. Maintenant dans toutes les régions de France on prend le temps, on respecte davantage la nature, on se base sur la technique et l' on a des vins de meilleure qualité qu’il y a 60 ans. Les vignerons ont pris le temps de faire de la qualité et ce serait bien qu’en psy on prenne encore le temps pour installer une qualité relationnelle plutôt que technique.
Faites-vous une différence le vin bio et le vin non bio ?
Oui et pour moi la varie différence c’est qu’avec un vin non bio, je sais à quoi je m’attends. Si c’est un bordeaux ou un Val de Loire, il ne va pas varier énormément.. Tandis qu’un vin nature comprend des variations. Même à l’intérieur d’une maison vinicole, je peux trouver un vin très différent d’une bouteille à l’autre et le vin nature a parfois des goûts plus particuliers. C’est aussi une piste très intéressante de pouvoir développer le vin en rajoutant quelque chose à l’éventail de choix que peuvent avoir les personnes.. Le vin bio plus sain ? Non je ne pense pas. Si on faisait des recherches sur les produits chimiques utilisés dans les sols et les insecticides là on pourrait peut-être voir des différences à long terme sur de grands consommateurs. Je fais confiance aux vins nature car ils se débarrassent de tous ces produits toxiques. Mais même les vins non bio le font aussi maintenant avec de moins en moins de produits chimiques. Il existe une tendance vers cette simplification là. Mais ça demande beaucoup plus de travail de contrôler tout ça et d’être en harmonie avec les variations de la nature.
Vos vins préférés ?
Cela dépend de mon humeur et de ce que je vais manger. Avec le fois gras par exemple, j’aime bien les vins de la vallée de la Loire. J’essaye de faire découvrir les vins du Canada car souvent on les néglige. La très belle région de L'Okanagan possède des vins extraordinaires. Comme je suis chef de département au campus à côté de Dubaï, et sans ma famille restée au Canada, je ne bois pratiquement plus d’alcool sauf quand je suis avec des amis. J’aime prendre du vin avec parcimonie et équilibre sauf si c’est vraiment une grosse fête. On dit que même boire avec modération ce n’est pas sans risque. Les études à ce sujet sont assez contradictoires. Je n’ai pas de recommandations chiffrées à faire si ce n’est celles déjà connues. C’est un message que doivent lancer les médecins : il est très difficile d’interdire car si on interdit on passe peut-être à côté de quelque chose mais en même temps, il faut établir la limite très clairement…
Agnès Figueras-Lenattier
13:00 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychiatrie, vin, parallèle
Emmanuel Stip
Vin et psychiatrie
12:59 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychiatrie, vin, parallèle
dimanche, 01 août 2021
Docteur Caroline Agostini
 Caroline Agostini psychiatre au sein de l'établissement public de santé mentale, assure la présidence depuis 5 ans de « Sport en tête « organisme qui regroupe les associations sportives des établissements psychiatriques et des structures médicosociales. Avec pour but de promouvoir le sport comme outil de soin en complément du traitement chimique. Caroline Agostini souhaite faire perdurer cette promotion de l’activité physique en santé mentale en faisant prendre conscience de son importance et en élaborant des projets de soin pour les patients.
Caroline Agostini psychiatre au sein de l'établissement public de santé mentale, assure la présidence depuis 5 ans de « Sport en tête « organisme qui regroupe les associations sportives des établissements psychiatriques et des structures médicosociales. Avec pour but de promouvoir le sport comme outil de soin en complément du traitement chimique. Caroline Agostini souhaite faire perdurer cette promotion de l’activité physique en santé mentale en faisant prendre conscience de son importance et en élaborant des projets de soin pour les patients.
Vous êtes présidente de « Sport en tête. ». Qu’est-ce exactement.
« Sport en tête » regroupe plus de 300 établissements à la fois médico sociaux et HP, avec aussi la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Certains m’ont fait venir, je suis allée à Marseille, Paris, en Bretagne. J’essaye quand les soignants m’appellent de valoriser tout cet aspect soin par le sport. On fait des assemblées générales et l’on peut rencontrer tous les soignants des hôpitaux de France. Récemment un soignant m’a dit : « Notre direction n’est pas du tout sensibilisée à cet aspect sportif, comment pouvez-vous nous aider. ? » Je suis assez ouverte et disponible pour aider et expliquer comment cela fonctionne. C’est juste un problème d’organisation… Actuellement « Sport en Tête » organise différents séjours thérapeutiques, un séjour ski, un séjour randonnée en Sologne, deux séjours multi sport dans le Sud de la France et le séjour voile en tête qui organise une régate. Généralement, à peu près 160 patients se regroupent sur l’eau pendant une semaine et vivent 24h/ 24 sur un habitable avec deux soignants et un skipper professionnel. La 1ère édition s’est déroulée en 1992 et après ont eu lieu des interventions dans des congrès et autres.
A Caen avec la naissance du sport sur ordonnance plusieurs pathologies (troubles articulaires, diabète, obésité infantile) ont été mises en place dont la psychiatrie !
Depuis une dizaine d’années, j’ai commencé à développer l’activité physique en santé mentale au niveau de l’hôpital en lien avec la ville et nous sommes les pionniers en matière de psychiatrie. Un soignant et un éducateur sportif participaient aux activités mises en place. Lorsque la nouvelle municipalité a décidé d’instaurer le sport sur ordonnance, ils ont fait appel à nous étant donné que l’on travaillait déjà ensemble et que cette collaboration fonctionnait bien. Ce sont à la fois des médecins généralistes et des psychiatres qui prescrivent. Une fois que le patient est stabilisé et qu’il sort de l’hôpital, il peut accéder au sport sur ordonnance. L’idée c’est qu’une fois sorti, le sport fasse partie de son quotidien. Qu’il intègre un club de la ville tout en étant accompagné ou bien directement en lien avec nous. Mais si l’on sent que le patient a encore besoin d’être soutenu, on passe par le tremplin du sport sur ordonnance. Et inversement si en ville, ils ont des patients qu’ils estiment un peu trop fragiles, ils nous les renvoient.
Un matériel sportif très adapté
On a la chance d’avoir un gymnase à l’intérieur de l’hôpital et à notre disposition plusieurs structures de la ville de Caen. Une salle de gym avec un éducateur, un vélodrome avec un formateur, une piscine. Nous avons entre 18 à 20 activités par semaine à proposer et les clubs privés de la ville viennent vers nous. On a eu un cycle zumba qui a très bien fonctionné et les patients nous demandent de le refaire. Egalement au programme un cycle marche nordique animé par un éducateur du Caen Athlétique Club. Il existe un véritable échange entre la ville de Caen et l’établissement public de santé mentale l’EPSM.
,
Comment avez-vous eu l’idée de concilier sport et psychiatrie ?
Lorsque l’on se dépense physiquement, on se sent mieux et je m’étais dit que mes patients pouvaient tout à fait se situer dans cette logique là. En les voyant assis sur une chaise à regarder le temps qui passe, à prendre du poids avec les neuroleptiques, être atteints de syndromes métaboliques, je souhaitais vivement trouver les moyens de mettre en place des exercices physiques. Etant donné leur sédentarité, leurs facteurs de risque cardio-vasculaire, nos patients ont une durée de vie de 15 à 20 ans de moins que la population générale. Il fallait trouver un palliatif à cette mortalité prématurée.
Certains patients doivent sûrement rechigner à faire du sport ?
Oui, mais notre intérêt à nous c’est d’arriver à les persuader, avec un entretien et une recherche commune de notion de plaisir sportif éprouvé dans leur enfance. Même un patient non sportif, il est possible de le faire bouger. On va le faire marcher, lui fixer des objectifs très simples au début, lui redonner confiance en lui, et lui faire prendre conscience petit à petit qu’il fait déjà de l’activité physique quand par exemple, il ouvre ses volets. Lui enlever les idées erronées et oublier la recherche de performance. On peut aussi le motiver en disant « Vous venez à la consultation, vous vous arrêtez à l’arrêt de bus précédent et vous finissez à pied. On commence tout doucement et puis petit à petit on augmente l’intensité pour arriver à ce qu’il fasse du vélo, du tennis. Certains patients à la recherche de compétition viennent uniquement lorsque l’on organise des tournois ou des séjours. On essaye d’organiser des séances 2 fois par semaine minimum. Après, si le patient est demandeur, on augmente.
Des possibilités de réduire les traitements
On essaye de mettre en place les 150 mn recommandées de façon hebdomadaire. Si le patient n’est pas stabilisé, on s’en occupe pareillement. Mais on ne va pas le faire sortir tout de suite à l’extérieur. Ill vient dans le service et l’on met en place dès le premier jour des activités très courtes au départ de manière individuelle. On a des médecins somaticiens qui nous font un certificat de non contre-indication et les patients démarrent tout de suite. On fait des évaluations individuelles avant de les intégrer à un groupe et des plaquettes leur expliquent bien les choses. Je suis en train de travailler avec la haute autorité de santé pour faire des fiches patients, afin de se rendre compte des bienfaits à long terme de l’activité physique. Des initiatives peuvent être prises au niveau des anxiolytiques avec réduction mais pas de manière systématique. C’est au cas par cas. En tout cas après des séjours comme la voile, on a vu des patients ne plus prendre de médicaments pour dormir…
Existe-t-il une complémentarité au niveau du cerveau entre sport et médicaments ?
L’activité physique qui donne cette sensation de bien-être et qui englobe une sécrétion d’endorphines et de sérotonine implique une diminution des syndromes dépressifs, du stress avec moins de sécrétion de cortisol, et une amélioration de la qualité du sommeil. Les antidépresseurs par exemple augmentent également la sécrétion de sérotonine. Mais avec l’activité physique, cela se déroule de façon physiologique. En fait, d’après les études en cours, des effets immunologiques entraîneraient ces résultats. Depuis 5,6 ans beaucoup d’informations circulent sur les recherches concernant l’activité physique, les recommandations, les effets immédiats, à long terme et sur ce qui se passe au niveau biologique, neurologique. On s’aperçoit qu’il existe une diminution de la neuro-inflammation avec une amélioration de la plasticité cérébrale jouant sur la mémoire et un effet protecteur sur les maladies neuro dégénératives. Au long cours, cela prévient également les risques de rechute d’un syndrome dépressif. Important aussi pour éliminer les médicaments avec une augmentation de la fréquence cardiaque respiratoire.
Y a-t-il des pathologies où le sport joue plus que pour d’autres ?
Non c’est pour tout le monde pareil. L’idée c’est que ça reste dans les habitudes de vie et que ce soit un plaisir. C’est vraiment important car si le patient vit l’activité physique comme une contrainte, l’impact sur la santé mentale sera réduit avec risque d’abandon. Or pour que ce soit efficace, il faut une régularité. C’est surtout le degré d’intensité qui compte. Et bien évidemment, on ne va pas faire faire un sport de combat à une personne agressive qui décompense. Un patient suicidaire ne va pas faire de l’escalade ou du parachutisme. On adapte également l’intensité à l’antériorité de la pratique des patients. J’en ai vu qui arrivent complètement pragmatiques, la raquette qui traîne en disant « Qu’est-ce que je fais là ? Or, une fois qu’ils sont sur le terrain, qu’il se mettent à jouer au badminton ; ce ne sont plus du tout les mêmes personnes. Je me disais « Ils ne vont pas revenir », et bien si. Mais un accompagnement est nécessaire. C’est ce sur quoi l'on insiste lorsque d’autres hôpitaux nous appellent pour savoir un peu comment se structurer et mettre en place des activités physiques. Avec un duo soignant et éducateur sportif diplômés. C’est très valorisant qu’une personne qui ne soit pas dans le milieu soignant s’intéresse à la situation et l’intervention d’un soignant est très sécurisante pour l’éducateur sportif et pour le patient... Souvent l’argument qui revient pour éviter de bouger c’est « Vous avez vu le traitement que j’ai « et je leur dis « On va essayer, vous allez voir que cela n’aura pas d’impact ». Une fois qu’ils sont accompagnés, mobilisés, je peux vous dire que je n’entends plus cette excuse. Si des patients arrêtent et rechutent, ce n’est pas grave, je ne lâche pas l’affaire. On a un gros travail de phoning avec les soignants de façon hebdomadaire, on fait un point et quand on a appelé deux fois un malade et qu’il ne vient pas un mail est adressé aux confrères en disant « attention, il décroche, il faut nous le renvoyer, que l’on fasse le point avec lui »…
Pour moins fumer et ne pas trop grossir, "bouger" a aussi son efficacité !
Oui, cela joue justement sur les risques de facteurs cardio-vasculaires. Comme nos patients fument beaucoup, effectivement c’est aussi un argument de dire « Faites de l’activité physique » et l'on essaye par la même occasion de diminuer un peu le tabac. Je ne leur dis pas « arrêtez tout de suite « avec le côté rabat-joie, je ne suis pas là pour ça, mais par contre j’arrive à leur faire accepter d’oublier la cigarette pendant la séance. C’est une de moins, et comme une petite victoire. Tout est bon pour encourager le patient. Je ne leur dis pas « Vous allez perdre du poids car on s’est aperçu qu’ils viennent faire du sport pour perdre des kilos ». Je leur explique qu’ils ne vont pas maigrir dans la semaine, que cella ne fonctionne pas ainsi mais qu’ils vont se raffermir. Et dans un 2ème temps on fait une enquête nutritionnelle. Souvent mes patients viennent avec deux bouteilles de coca dans leur sac et on je leur explique qu’avant de faire du sport pour perdre du poids, il faudrait déjà revoir leur alimentation et tout ce qui gravite autour.… On fait un état des lieux, on parle des repas qu’ils doivent faire, ne pas faire. En fait, les neuroleptiques provoquent une appétence pour le sucre et on leur explique. On essaye d’être acteur aussi des soins…
Comment gérez-vous le Covid ?
Durant les confinements, je me suis battue pour laisser le service ouvert. On a adapté nos pratiques pour que les patients essentiellement hospitalisés puissent en bénéficier puisqu’en ville tout était fermé. Cela avait lieu tous les jours et ce fut très bénéfique au sein des services…
Que souhaitez-vous comme améliorations ?
Dans les hôpitaux, la priorité n’est pas l’activité physique et il faudrait que cette notion de soin rentre dans les moeurs. Mais au niveau de la faculté les jeunes médecins en entendent parler. Et puis la Haute Autorité de santé est en train de travailler dessus. C’est maintenant reconnu et lors de l’interrogatoire on va de plus en plus demander au patient s’il fait du sport au même titre que s’il boit ou fume…
Agnès Figueras-Lenattier
13:08 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 13 juillet 2021
Geraud Benech


 Organiste, co-auteur, metteur en scène, Gérard Benech a adapté et mis en scène deux spectacles en cours en ce moment au théâtre de la Contrescarpe. L’un est basé sur le livre de Camus « La chute » et l’autre évoque la personnalité de Chirac. Dans cet entretien, il explique sa manière de travailler…
Organiste, co-auteur, metteur en scène, Gérard Benech a adapté et mis en scène deux spectacles en cours en ce moment au théâtre de la Contrescarpe. L’un est basé sur le livre de Camus « La chute » et l’autre évoque la personnalité de Chirac. Dans cet entretien, il explique sa manière de travailler…
Vous dites préférez chercher la théâtralité dans un texte plutôt que de mettre en scène un écrit déjà crée pour le théâtre. Qu’est-ce qui vous a paru digne de théâtralité dans « La chute » de Camus ?
L’on trouve forcément quelque chose de l’ordre du théâtre dans ce personnage de Jean Baptiste Clamence qui s’adresse à cet autre que l’on ne voit pas mais qui dialogue avec lui. Même s’il a vraiment la main sur ce dialogue, le texte fait vraiment exister cet autre. Ce point de départ dramaturgique me semblait très intéressant théâtralement pour le spectateur. De plus, cela ne ressemble en rien à ce que Camus a pu écrire pour le théâtre qui bien que formidable est très inscrit formellement dans son temps. M’approprier un texte comme « La chute » me donne davantage de liberté car je peux réellement construire une dramaturgie autour…
Comment s’est déroulée l’adaptation ?
Elle s’est faite avec Stanislas de la Touche, comédien de la pièce avec qui je travaille depuis 12 ans. On conçoit les spectacles ensemble, c’est un vrai partenariat. Auparavant, l’ on a construit des spectacles autour de Ferdinand Céline , Albert Camus, Maurice Genevoix. Pour « La chute », l’on s’est basé sur une adaptation que Stanislas de la Touche avait interprété d’après une autre mise en scène en conservant le principe des 6 journées qui composent le texte. Parfois celui-ci est très discursif et lui rendre un rythme a fait partie de notre travail. On a fait en sorte de privilégier ce qui est davantage porteur d’action plutôt que de la pure réflexion théorique. La vision de Camus qui fait naître l’ironie du personnage est très marquante, très actuelle et très intéressante à faire résonner actuellement. Comme un regard désabusé sur le monde mais écrit avec élégance et sans amertume. A la fin, Jean-Baptiste Clamence plonge dans une forme de folie et devient un homme revenu de tout qui rit et qui nous le fait partager sur un mode ironique.
Le texte de Camus est-il totalement respecté ?
On a voulu garder le texte dans l’ordre à part ce récit du pont que l’on retrouve à plusieurs endroits du texte et qui selon moi constitue le noyau dur du spectacle. Je l’ai mis au début, et je le remets plus tard pour montrer que c’est vraiment le point d’appui. Mon idée était à travers ce récit fondateur de la problématique du personnage, de construire un individu au profil d’exilé, un peu décadent qui règle une affaire personnelle autour de cette histoire dont il est victime et qui déclenche tout. Se profile une espèce d’auto-analyse, d’introspection par le biais d’accessoires comme un magnétophone et une machine à écrire. L’auteur écrit l’histoire et en même temps la raconte. Il règne une sorte de parallèle, un va et vient entre ce qui pourrait représenter ce bar situé à Amsterdam représenté par univers sonore d’un côté et un univers visuel de l’autre qui représente l’intimité de sa petite chambre. Des bruits de porte se font entendre et j’ai essayé d’imaginer un lieu dans lequel il revient doté de cette volonté de creuser cette histoire qui lui est arrivée.
On sent une progression jusqu’à la présence d’une certaine folie !
Oui mais cette folie est assez mystérieuse, peu classique et ne ressemble pas à un état de folie que l’ on peut observer habituellement dans certaines pièces. Ce sont plus des accès de folie qui constituent ce que Camus appelle « La chute ». Lorsque la chute survient le matin et qu’il erre avec l’impression de régner sur le monde, quelque chose qui dépasse la normalité se met en place. Il est habité par une espèce d’épiphanie, mais on comprend que passé ce moment là, il va revenir à ce qu’il est véritablement . On a essayé de représenter cet état par vagues avec un certain lâcher-prise, une certaine folie et un retour à la normale. En fait, selon moi tout est contrôlé…
Dans ce spectacle, il existe un gros travail sur le corps !
Oui c’est important pour ce comédien qui aime beaucoup aborder tous les rôles du point de vue du corps, du physique. Il a été formé au théâtre physique et pour lui c’est primordial de ressentir le texte à travers l’énergie du corps. Je trouve d’ailleurs cela assez juste s’agissant du personnage tel qu’il se décrit souvent c’est-à-dire comme un danseur. Et puis c’est Camus, "le danseur". Quelqu’un qui est dans le sport, la danse, la séduction. Dans ce sens là, c’est un peu l’anti-Sartre. Il assume son corps, en jouit. Le personnage est donc le reflet de la personnalité de Camus et se décrit lui-même comme un ex séducteur, un homme qui possède les preuves de ce qu’il avance. C’est ce sur quoi nous avons voulu insister…
Vous avez recours à beaucoup d’accessoires ?
Comme je l’ai dit le magnétophone et la machine à écrire sont là pour raconter ce travail d’introspection racontée visuellement et aussi gestuellement. Mettre sous différentes formes cette expérience avant qu’elle ne devienne un texte nous a paru important. C’est un souvenir, une parole qui devient une parole enregistrée, un texte tapé que l’on réécoute, que l’on enregistre. Le miroir a un rôle un peu différent.. Il raconte aussi cette 2ème dimension, celle de la folie du personnage, ce dédoublement. Le personnage se regarde au début pendant un bon moment. Un moment de surprise se profile lorsque l’image apparaît progressivement dans le miroir. C’est vraiment l’idée de son inconscient qui se matérialise derrière lui, ce personnage moqueur, errant. Une sorte de conscience sans morale juste là pour rire encore plus fort que ce dont il rit lui-même. Quant au mannequin, il signifie l’image de cette femme habillée en noir qui porte son propre deuil. Elle est là pendant le spectacle comme une espèce de statue qui se rappelle au bon souvenir de cet homme qui n’a rien fait pour la sauver… A la fin, il va vers elle à nouveau avec ce dernier rappel de la scène du pont.
La musique est très présente !
Avant l’ouverture du « Hollandais volant » de Wagner, on trouve l’histoire de la Hollande, du navire. Une belle illustration thématique à laquelle il me plaisait bien de penser . Existe aussi cette puissance épique contenue dans cette ouverture évoquant le retour de cette vision du point noir sur la mer, cette culpabilité qui le poursuit. Je trouvais que cette musique méritait de porter tout le lyrisme contenu dans ce texte. On entend aussi des musiques que j’ai créées moi-même, des effets sonores très contemporains. Et puis des emprunts musicaux avec « Le tombeau des regrets » de Sainte Colombe et la viole de gambe. Puis pour finir « Les pas sur le neige » de Debussy. Je mets du son dans tous mes spectacles. Pas forcément de la musique en tant que telle mais des bruits. Dans le dernier spectacle que j’avais fait sur Céline, j’ai utilisé « Les vexations « de Satie comme un leit motiv qui revient. Avec une bande son très chargée mais réaliste sur l’univers de la maison de Céline. Les danseuses en haut, les chiens qui aboient...
Lorsque vous avez adapté le film de Ken Loach " Moi, Daniel Blaké" avez-vous mis aussi beaucoup de musique ?
Il y a effectivement une très belle pièce de violon celtique irlandais très mélancolique à un moment donné qui revient. A un certain moment, émanait vraiment une sorte de bulle de mélancolie et je trouvais cette musique très adaptée.Mais c’est moins musical comme ambiance. J’ai voulu rester assez fidèle à l’esprit du film.
Pour « Chriac » il y a aussi des bruits au début qui en quelque sorte amorcent le spectacle !
Il y a une bande son mais assez brève que j’ai réalisée dans le but de porter l’univers onirique.. Je pars de cette femme qui écoute au casque une musique de relaxation avec des vagues, des cloches tibétaines et aussi de petits cailloux qui résonnent dans le vent et qui s’entrechoquent de manière aléatoire. Cela donne un univers sonore très lié à la méditation ; à ce genre de choses… J’aurais voulu en mettre plus mais je sentais que les comédiens ne le souhaitaient pas vraiment. J’ai donc essayé de tenir compte de leur désidérata.
Pourquoi Chirac ? A-t-il un côté théâtral selon vous ?
Nous ne sommes pas les seuls à avoir été attirés par le personnage et les politiques ont toujours fasciné. Toute la série des rois de Shakespeare sont des personnages politiques. Mais là c’est une façon d’aborder autrement l'homme non pas par la puissance du personnage dans son histoire mais par une sorte de subterfuge où on le retrouve après sa mort. L’idée est partie de Dominique Gosset mon co-auteur directeur du théâtre de la Contrescarpe et producteur du spectacle. Il est venu me voir et m’a dit sans avoir d’idée vraiment précise « Je veux faire un spectacle sur Chirac, je sens qu’il y a quelque chose d’intéressant à faire. » On a réfléchi, on a lu beaucoup de biographies, on a écouté de nombreuses interviews, notamment les cérémonies de vœux, les discours, les reportages sur lui. On a également parcouru les renseignements fournis par les deux personnes qui l’ont approché de la manière la plus intime Jean-Louis Debré et Jean-Luc Barré. Notre souhait était d’approcher Chirac par le bout un peu plus secret du personnage en essayant de percer ce qui se cache derrière le masque. Il a quelque chose de théâtral dans sa façon de s’exprimer, de se mouvoir. L’écriture du texte a été très longue 2 ans. On a fait 14 versions et on a vraiment peaufiné puisque le COVID nous en a laissé le temps. On a remis en cause beaucoup de choses à un certain moment. On s’est dit que l’on n’était pas sur la bonne voie, on a refait autrement pour finalement parvenir à une version qui nous a plu.
Y a-t-il selon vous quelque chose chez Chirac qu’il n’y a pas chez les autres ?
Oui comme quelque chose de plus savoureux !... Il existe ce rapport à l’inconscient collectif qu’il a déclenché peut-être malgré lui, et qu’il a entretenu habilement. Même si certaines personnes ont éprouvé de la haine à son égard, beaucoup d’autres ont éprouvé une véritable affection pour lui. Il rappelle un peu le personnage du roi dans l’ancien régime. Des personnes pour qui le peuple avait parfois une haine violente mais souvent aussi une sorte d’attachement car il les représentait. Quand j’ai commencé à travailler avec Dominique Gosset, je lui ai dit que Chirac me faisait penser à Henri IV. Le bravache, l’homme politique avant le roi qui chargeait à la tête de ses troupes. C’est l’homme au long nez, la bonne chair, les bons vins, les femmes, le franc parler et la capacité de s’y prendre avec le peuple.
Avez-vous trouvé l’acteur facilement ?
On a cherché un peu car ce n’est pas évident de trouver un comédien qui incarne bien Chirac. Marc Choupart a commencé assez jeune sa carrière à la Comédie française avec J.Pierre Vincent. Il vient du théâtre subventionné que je connais bien. J’ai souvent travaillé avec des acteurs de ce monde là avant de travailler avec ceux venant du privé. Il existe une grande exigence par rapport au travail et pour moi ce qui est primordial c’est d’avoir un comédien disponible pour aller au fond du travail de direction du jeu. Pour ce spectacle, on y a vraiment passé des heures, avec un vrai plaisir celui de comprendre qui était Chirac du point de vue du maniement de la langue. Comment il parle, quel rythme il emploie, comment il chante la langue. Le texte existe aussi avec les trous. C’est-à-dire dans les silences, les commentaires, dans l’écoute des uns et des autres. On a vraiment fait un travail de partition, et l’on a toujours voulu entendre Chirac le dire. On entendait sa voix, ses silences, son ironie, ses commentaires à peine perceptibles . Tout était déjà dans le texte. Une fois que l’on tient la langue on tient le personnage. Au moyen d’accessoires on a vraiment transformé le personnage. Il porte une perruque faite d’après des photos de Chirac par un des perruquiers de la comédie française, et les lunettes ont été prêtées par la maison Bonnet où se ravitaillait Chirac. Le personnel a été délicieux et ravi de participer à cette aventure. Je pense qu’il y a des moments où l’on a l’impression d’être en face de Chirac et j’aime beaucoup ce trouble. Si je le fais c’est d’abord pour m’impressionner personnellement, pour me donner cette émotion du trouble. J’ai une saine naïveté de spectateur d’enfant se laissant happer par l’illusion du théâtre. Cela me plaît beaucoup et j’aime profondément jouer avec cette technique.
Une manière différente de procéder avec les deux comédiens :
Quant à l’actrice Fabienne Galloux, elle est arrivée beaucoup plus tard car elle a remplacé l’actrice initiale. Elle vient du privé et du boulevard et la manière de la diriger était totalement différente. Il a fallu l’inciter à ralentir, à chercher les émotions, une fragilité car généralement les comédiens de boulevard fonctionnent sur une énergie. Mais c’est une comédienne vraiment brillante qui donne bien satisfaction quand elle a compris ce qu’on lui demande. Dans la pièce, c’est un personnage un peu polymorphe car à certains moments elle se transforme en psychanalyste, puis en journaliste par certaines questions où elle titille l’homme politique. On a imaginé quelqu’un qui sans doute a été séduite par cet homme et peut-être comme une femme à un moment donné en quête d’une figure paternelle. Qui dans son rêve imagine que Chirac pourrait être son père.
Il existe aussi un travail intéressant sur l'éclairage!
C’est un travail qui tient compte de ces petits lieux qui accueillent un certain nombre de spectacles à la suite et qui n’ont pas un nombre de lignes de lumières très importants. Il faut donc se montrer d’autant plus débrouillard pour éclairer. Pour « La chute » j’ai vraiment voulu trouver des lumières. Mais pas des lumières de face ou de pleins feux et je veux montrer le plateau le moins possible. J’essaye d’éclairer les comédiens, les objets, de désigner certaines zones mais un plein feu sur le plateau je n’ai jamais fait, je ne peux pas. Pour moi c’est un processus qui dépoétise tout car on montre le théâtre. Or si on le voit tel qu’il est dans sa réalité, on ne peut pas rêver. Il faut le voir dans son illusion et la lumière aide beaucoup. Pour le décor, on a 2 fauteuils et une chaise prêtés par le Sénat. L’idée c’était vraiment d’être dans un jardin public. Le reste de ce qui est projeté ce sont des panneaux réfléchissants avec une vision un peu trouble, un peu déformée des images et des comédiens. Avec selon l’endroit où l’on est placé un regard un peu différent... On entre dans le rêve, c’est la dramaturgie de cette pièce là. Les films projetés ont été réalisés à partir de photos dont on a essayé d’optimiser l’aspect onirique… Elles sont de Romain Veillon un des meilleurs photographes selon moi du mouvement Urbex.
Vous considérez-vous comme un metteur en scène plutôt directif ou au contraire qui laisse plutôt libre le comédien ?
Je pense que je suis très accompagnant et je pars toujours du comédien. Je ne fais pas jouer du saxophone à une clarinette. Je pars du comédien, de ce qu’il est physiquement, vocalement et puis aussi du matériau que l’on travaille, du texte, du personnage et j’accompagne le comédien au plus près. J’ai une idée très précise de la manière dont la langue doit sonner ; c’est mon oreille musicale. Et j’essaye de m’en servir sans contrainte ; Mon plaisir c’est la création en équipe sans les relations de pouvoir. Parfois, je prends des décisions, parfois j’argumente, mais c’est vraiment un travail en relation avec la personnalité du comédien que j’aime réaliser…
Agnès Figueras-Lenattier
12:43 Publié dans Interviews | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : " la chute", " chirac" spectacles en cours